Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada
Aperçu visant à éclairer la discussion sur l’établissement des priorités des activités scientifiques sur l’eau douce
Remerciements
Nous tenons à remercier les auteurs et les contributeurs d’avoir pris le temps de rédiger et de réviser les chapitres de cette synthèse. Nous tenons également à remercier les examinateurs supplémentaires suivants :
- Audrey Roy-Lachapelle
- Claire Pinsonnault
- Daniel Caissie
- Daryl McGoldrick
- Emma Hodgson
- François Gagné
- Genevieve Tardif
- Gerald Tetreault
- Linda Maddison
- Mark McMaster
- Marten Koops
- Martha Guy
- Mike Bradford
- Rob Letcher
- Roland Cormier
- Sandra Weston
- Sara Radovan
- Shirley-Anne Smyth
- Susan Doka
- Sylvie Poirier Larabie
- Tom Bird
- Vimal Balakrishnan
Nous tenons également à remercier les membres du groupe de travail interdépartemental pour leurs précieux conseils et leur contribution :
- Alain Houde
- Andrew Davidson
- Chris Jordan
- Christine Bissonnette
- Eric Boisvert
- Felicia Kolonjari
- Gavin Christie
- Karl Schaefer
- Keith Clark
- Kelly Hodgson
- Lynn Bouvier
- Laura Cervoni
- Marina Steffensen
- Réjean Couture
- Sen Wang
- Shusen Wang
Nous tenons également à reconnaitre les collègues et équipes suivants pour leur contribution inestimable à la finalisation de cette synthèse :
- Joanne Dziuba et le service graphique d’ECCC-DSTE
- Jacqui Milne
- Cynthia Watson
Sincèrement,
Secrétariat de la Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada
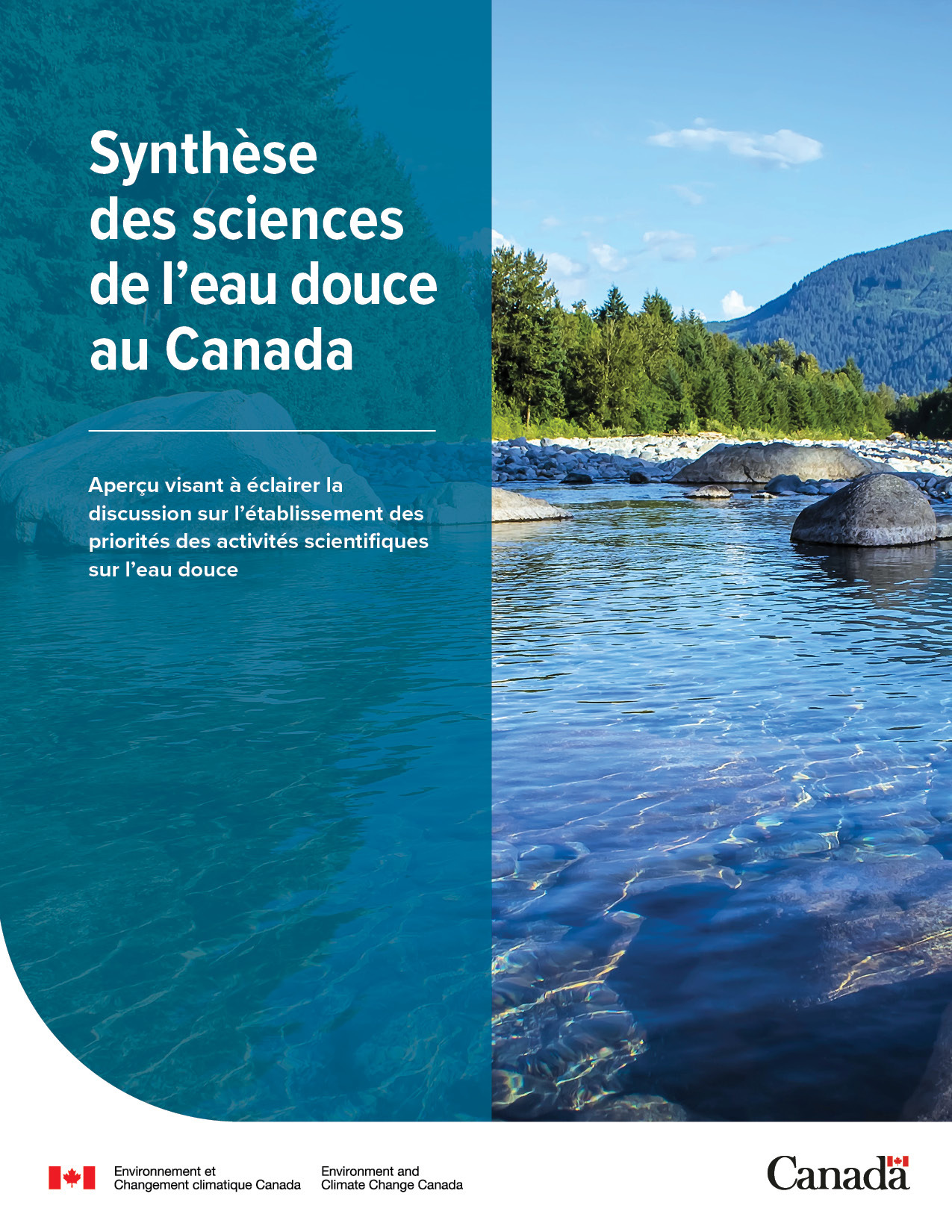
Téléchargez le format alternatif
(Format PDF; 7,6 Mo, 56 pages)
Sur cette page
Sommaire
Le portait des sciences de l’eau douce au Canada est vaste et complexe, et comprend une riche expertise du milieu universitaire, du gouvernement, d’organisations non gouvernementales, autochtones et scientifiques communautaires dans le domaine de l’eau. En vue de comprendre et de synthétiser l’état actuel des sciences de l’eau douce au Canada, une équipe de plus de 100 experts en la matière d’ECCC, d’AAC, de RNCan et du MPO a examiné 25 grands défis, priorités et enjeux relatifs à l’eau douce et enjeux qui affectent les écosystèmes aquatiques du pays; le tout portait principalement sur la compréhension actuelle de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques. Le présent document, soit la Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada, donne un aperçu de cette enquête qui met en évidence les grands messages à retenir et les besoins scientifiques à venir.
Les 25 priorités, défis et enjeux relatifs à l’eau douce qui figurent dans le présent résumé ont été classés sous cinq thèmes nationaux, à savoir l’élaboration et la prestation de programmes et de stratégies scientifiques en collaboration avec les Autochtones, les changements climatiques et la variabilité du climat, les changements quant à l’utilisation des terres et de l’eau, les contaminants et la pollution, ainsi que les défis transversaux.
Bien que la synthèse des sciences de l’eau douce au Canada ne soit pas destinée à constituer une collection définitive de tous les enjeux relatifs à l’eau douce auxquels notre pays doit faire face, elle peut être considérée comme une occasion d’avancer de nouvelles questions, défis et opportunités pour alimenter la discussion sur la science intégrée de l’eau douce, la responsabilité, l’intendance environnementale, la gestion et l’action avec des partenaires clés à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement fédéral.
Saisir les opportunités
Comme une prochaine étape, cette synthèse servira de point de départ qui permettra d’élaborer un programme scientifique national sur l’eau douce.
Cinq éléments fondamentaux ont été soulevés à plusieurs reprises dans la Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada en tant que grands résultats à mettre en œuvre :
- Une coordination scientifique nationale pour orienter la collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire sur les priorités et les besoins pancanadiens.
- Des sciences de l’eau douce axées sur les utilisateurs pour appuyer les priorités locales et régionales et celles propres aux bassins versants au sein d’un cadre national.
- La mobilisation des connaissances centrée sur les utilisateurs comme mécanisme d’intégration des outils et des experts afin de mieux rapprocher, traduire et refléter les besoins des utilisateurs des sciences de l’eau douce au Canada.
- Des outils numériques, des infrastructures essentielles et novatrices et des normes pour améliorer les sciences de l’eau douce ainsi que pour opérationnaliser la connectivité et la mobilisation des connaissances sur l’eau douce.
- Raccordement, tissage et tressage du savoir autochtone, pour représenter avec respect les divers points de vue et systèmes de connaissances autochtones distincts.
Cette prochaine étape serait un moyen de cibler la collaboration et la coordination des sciences de l’eau douce afin d’éclairer les décisions de gestion et d’investissement. On pourrait ainsi établir l’ordre des priorités, harmoniser et améliorer la coordination des sciences de l’eau douce à l’échelle nationale, ce qui constituerait une feuille de route pour les investisseurs, les intervenants et les consommateurs des sciences de l’eau douce au pays. En fin de compte, ce programme ferait progresser la science de l’eau douce au Canada en commençant par les besoins ou les défis les plus urgents afin d’atteindre les objectifs nationaux et régionaux d’intendance durable de l’eau douce.
Introduction

Description textuelle
- 25 Principales zones d’eau douce étudiées
- 4 Ministères fédéraux à vocation scientifique ont collaboré (ECCC, AAC, RNCan, MPO)
- >100 Auteurs contributeurs, principalement des chercheurs scientifiques d'ECCC, d’AAC, de RNCan et du MPO
- 114 Participants à l’atelier (fédéraux, provinciaux et territoriaux, municipaux, autochtones, ONG, universitaires) – 10 au 12 février 2021 Atelier scientifique sur l’eau douce
Le portait des sciences de l’eau douce au Canada est vaste et complexe, et comprend une riche expertise du milieu universitaire, du gouvernement, d’organisations non gouvernementales, autochtones et scientifiques communautaires dans le domaine de l’eau. De nombreux ministères et organismes fédéraux mènent des activités scientifiques qui concernent l’eau douce, notamment Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Santé Canada, Parcs Canada, et le Conseil national de recherches du Canada, qui assurent tous un leadership scientifique quant aux responsabilités fédérales et aux obligations nationales. De plus, le financement de la recherche sur l’eau par les conseils subventionnaires et les programmes de chaires de recherche et d’excellence a permis de créer un réseau important d’experts en matière d’eau dans le milieu universitaire. Au-delà des universités, il existe un nombre croissant de programmes locaux et régionaux qui appuient la gestion de l’eau douce, comme les programmes de gardiens autochtones, les programmes de surveillance communautaires et les activités scientifiques citoyennes inclusives. La collaboration dans le cadre de ces programmes a consolidé un réseau déjà important des sciences de l’eau et de maîtrise des connaissances.
En vue de comprendre et de synthétiser l’état actuel des sciences de l’eau douce au Canada, une équipe de plus de 100 experts en la matière d’ECCC, d’AAC, de RNCan et du MPO a examiné 25 grands défis, priorités et enjeux relatifs à l’eau douce et enjeux qui affectent les écosystèmes aquatiques du pays; le tout portait principalement sur la compréhension actuelle de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques. Le présent document, soit la Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada, donne un aperçu de cette enquête qui met en évidence les grands messages à retenir et les besoins scientifiques à venir.
Cet aperçu vise de nombreux bénéficiaires potentiels. Il servira de base qui éclairera la hiérarchisation des besoins ou des questions concernant les sciences de l’eau douce au Canada et de point de départ à l’élaboration d’un programme scientifique national sur l’eau douce. Il fournit également un soutien scientifique pour faire progresser les engagements du gouvernement du Canada en matière d’eau douce, dont la création d’une Agence de l'eau du Canada (AEC) et les priorités énoncées dans le Plan d’action sur l’eau douce. Un atelier sur les sciences de l’eau douce a eu lieu en février 2021 afin de consolider les efforts déployés pour créer cet aperçu et discuter des considérations relatives aux prochaines étapes.
Les enquêtes sur les thèmes entourant l’eau douce ont largement puisé dans des disciplines complémentaires et dans les points de vue d’ECCC, d’AAC, de RNCan et du MPO. C’est là la preuve de l’étendue de la compétence en matière de sciences aquatiques que le Canada a acquise, en s’attaquant à des défis comme le bilan hydrique, la prolifération des algues nuisibles, les espèces envahissantes et la protection des services écosystémiques et de la biodiversité aquatique, le tout dans un climat en évolution. Bien que les priorités et les lacunes scientifiques continueront d’évoluer au-delà des sujets synthétisés ici, la compréhension scientifique de ces questions et d’autres questions liées à l’eau douce est définie, ciblée et hautement collaborative.
Cet aperçu présente les grands messages, les résumés ainsi que les principaux besoins et lacunes de cet ensemble de 25 priorités relatives à l’eau douce, d’un point de vue national et régional, en commençant par une réflexion sur les possibilités d’élaboration conjointe de programmes scientifiques autochtones, en tenant compte avec respect des systèmes de connaissances, le cas échéant. Les icônes qui représentent chacun des sujets étudiés ici sont utilisées partout dans le document pour refléter et mettre en valeur rapidement les interrelations entre eux, ce qui illustre le réseau de liens entre les enjeux d’eau douce et l’environnement canadien entre les côtes. L’aperçu se termine par les besoins fondamentaux relevés pour ces sujets ainsi que les possibilités quant aux prochaines étapes.
Élaboration conjointe avec les Autochtones et mise en œuvre de programmes et de stratégies scientifiques
Les peuples autochtones ont une relation particulière avec l’eau qui remonte à des temps immémoriaux. L’eau saine est essentielle à la vie. L’eau est notre ressource la plus précieuse, mais l’eau douce représente moins de 3 % de l’eau à l’échelle mondiale. Malheureusement, la dégradation de la qualité de l’eau douce est très répandue, et la qualité de l’eau est particulièrement dégradée dans de nombreuses collectivités rurales et autochtones qui continuent d’être soumises à des avis d’ébullition d’eau ou de non‑consommation. On s’attend à ce que les changements climatiques exacerbent ces défis et, par conséquent, la poursuite de la dégradation des ressources en eau douce constitue une menace importante pour la santé de tous les Canadiens, en particulier pour les peuples autochtones. Dans un contexte où l’on cherche à mieux soutenir la prise en charge des résultats de la recherche par les collectivités, l’élaboration conjointe avec les Autochtones est une approche évidente et attendue depuis longtemps de la recherche dans des domaines où les solutions singulières ne sont pas réalistes. L’élaboration conjointe, égale et respectueuse est particulièrement bien adaptée pour relever les défis complexes des changements climatiques, de la perte de biodiversité et des effets cumulatifs en faveur de la protection des ressources en eau douce du Canada et d’une véritable réconciliation avec les peuples autochtones.
Auteurs et contributeurs
Le codéveloppement autochtone et la mise en œuvre des programmes et des stratégies scientifiques
Autheurs : Alexa Alexander-Trusiak1, Katie Rosa2, E. Agnes Blukacz-Richards2, Jennifer Galloway3, Steven Alexander4, et Samantha David5
1 Environnement et changement climatique Canada / Université du Nouveau-Brunswick
2 Environnement et changement climatique Canada
3 Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada
4 Pêches et des océans du Canada
5 Agriculture et Agroalimentaire Canada
Messages clés
L’eau est synonyme de vie. Les peuples autochtones ont une relation spirituelle profonde avec l’eau. La reconnaissance de cette relation facilitera grandement le travail de collaboration visant à assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de l’eau.
La science autochtone est un moyen précieux, distinct et éprouvé de connaître et de comprendre l’environnement; elle est utilisée depuis des temps immémoriaux pour protéger les espèces et l’environnement (par exemple, la cartographie de la glace de mer et l’habitat essentiel des espèces en péril).
L’élaboration conjointe égale et respectueuse de la recherche, en particulier pour les initiatives dans le domaine de l’eau portant sur des défis environnementaux globaux tels que les changements climatiques, l’Arctique ou les effets cumulatifs, nécessite une approche plus globale et éthique. Des initiatives à long terme avec des partenaires autochtones pourraient servir de mécanisme d’innovation et d’établissement de relations constructives en faveur de la réconciliation.
Contexte
Les peuples autochtones ont un lien indéfectible et sacré avec la terre et l’eau qui remonte à des temps immémoriaux. L’eau est la source de vie (Nibi onje biimaadiiziiwin dans la loi de l’eau anishinaabe). Un large éventail d’activités traditionnelles dépendent de l’eau pour le transport, la consommation, la subsistance, le nettoyage, la purification spirituelle et d’autres activités culturelles. L’accès à une eau de qualité fournit également un habitat essentiel pour les plantes et les animaux sauvages, tels que les poissons et les caribous, qui font partie intégrante de la culture, de l’alimentation, de la médecine et de l’économie des Autochtones. Sans eau propre, toute vie périt. L’eau propre est reconnue comme un droit humain fondamental, car l’eau est indispensable à des moyens de subsistance sains, et elle est fondamentale à la dignité de tous les êtres humains (ONU, 2019). Le droit international relatif aux droits de la personne oblige les États à œuvrer en faveur de l’accès universel à l’eau pour tous, sans discrimination, tout en accordant la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin (objectif de développement durable des Nations Unies no 6 — Eau propre et assainissement). L’article 25 de laDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones consacre les droits des peuples autochtones à conserver et à renforcer leurs liens spirituels particuliers avec l’eau (voir Craft, 2019).
La science n’a jamais été uniquement occidentale — il faut plutôt un cadre plus équitable où tous les systèmes de connaissance peuvent coexister (Turnbull, 1997). La science autochtone et les approches occidentales visant à comprendre et à protéger l’eau en tant que ressource holistique ont beaucoup en commun.La science occidentale acquiert des connaissances par des observations et des mesures. La méthode scientifique est le fondement de la capacité de la science occidentale à fournir un contexte, une analyse et un aperçu. La science autochtone acquiert également des connaissances au moyen d’observations et de mesures. Ces observations sont transmises, dans de nombreux cas, par une tradition orale de transmission des connaissances ainsi que par les chants, la langue, les lois et les cérémonies, entre autres. La science autochtone est un système de connaissances dynamique en constante évolution grâce à l’expérience intergénérationnelle. La science autochtone est relationnelle et elle est donc entièrement intégrée à d’autres aspects des systèmes de savoir autochtone, tels que les connaissances juridiques, spirituelles et culturelles. Les relations entre les peuples autochtones, la terre, les organismes de l’écosystème et les milieux environnants sont les piliers sur lesquels la science autochtone s’appuie pour proposer un contexte, une interprétation et une vision approfondie. Dans les deux approches, la vérité émerge au fil du temps à partir de la mise en commun et de l’interprétation collective des résultats.
Tressage
« Une tresse est un objet unique composé de nombreuses fibres et de brins séparés; elle ne tire pas sa force d’une seule fibre qui parcourt toute sa longueur, mais des nombreuses fibres tissées ensemble. Imaginer un processus de tressage des fils […] nous permet de voir les possibilités de réconciliation sous différents angles et perspectives et ainsi de commencer à réimaginer ce qu’englobe justement une relation de nation à nation… » [traduction]
– Fitzgerald et Schwartz (2017)
Les forces de ces différentes approches se complètent étroitement, et le croisement de ces systèmes de connaissances peut donc permettre une meilleure compréhension. La science autochtone a une vision à long terme qui est hautement intégrative et comprend profondément que l’être humain fait partie des écosystèmes et doit rester en équilibre avec eux (Cercle d’experts autochtones, 2018). Les pratiques autochtones de gestion des terres sont aussi intrinsèquement orientées vers les systèmes et ont une portée globale. Les peuples autochtones sont également bien placés pour être les gardiens et les gestionnaires de l’eau des paysages sensibles sur le plan écologique, en particulier ceux qui concernent leurs terres traditionnelles. En revanche, la science occidentale dispose de connaissances approfondies sur les composantes des écosystèmes, bien que généralement sur des périodes beaucoup plus courtes. La géologie et la paléoécologie sont des exemples intéressants d’études qui se prêtent particulièrement bien au métissage des connaissances, car les deux approches embrassent des échelles spatiales locales à régionales sur des décennies à des millénaires. Une approche qui intègre les points de vue de la science autochtone et de la science occidentale, également appelée Etuaptmumk ou « vision à deux yeux », une approche micmaque, a un réel potentiel pour améliorer les résultats scientifiques et stratégiques pour tous les Canadiens (par exemple, Bartlett et coll., 2012; Reid et coll., 2020). Le savoir et l’innovation autochtones, de concert avec les pratiques de la science occidentale, sont particulièrement bien adaptés pour relever les défis des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de l’évaluation des risques écologiques en vue de protéger les ressources en eau douce du Canada (par exemple,What Conservation can learn from Indigenous Communities—Scientific American).
Programmes et initiatives en cours
Les vérifications des programmes autochtones menées par d’autres ministères mettent en évidence les sept piliers de programmes réussis. Par exemple, un examen des programmes autochtones de Pêches et Océans Canada (MPO) effectué par l’Institut national des pêches autochtones met en lumière les problèmes de cinq programmes de longue date, notamment la nécessité de conclure des accords pluriannuels plus simples, d’établir des exigences simples en matière de production de rapports, d’adopter des approches souples en matière de renforcement des capacités et de maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires autochtones afin de mieux répondre aux préoccupations qui se présentent. Les audits des programmes de RNCan ont également mis en évidence la nécessité de bien communiquer et de saisir les occasions de renforcer les relations entre les programmes et les titulaires de droits autochtones (par exemple, Audit du programme d’arpentage des terres du Canada de 2019).
Certaines vérifications signalent qu’aucun gouvernement ou organisation autochtone n’a été « interrogé » avec succès, à quelque stade que ce soit du programme. Pour les programmes destinés à soutenir les collectivités autochtones, ce manque de consultation constitue une lacune importante qui met en lumière un problème systémique important : les programmes du gouvernement du Canada ne répondent pas aux besoins de ceux qu’ils sont censés servir. Du point de vue de la collectivité, il y a également un manque d’enthousiasme pour participer à des mécanismes et à des programmes qui ne correspondent pas aux besoins et aux perspectives de la collectivité partenaire. Ce sont des obstacles qui pourraient être surmontés par l’établissement de relations respectueuses avec les partenaires autochtones. En l’absence d’un dialogue commun et mutuellement bénéfique, les programmes continueront à « ne pas parvenir à assurer une compréhension globale des titulaires de droits et à s’engager de manière continue avec eux » [traduction] (voir, par exemple, le Rapport d’audit et d’évaluation conjoints — mise en œuvre de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif de 2020).
Voici quelques exemples de programmes flexibles existants qui soutiennent la recherche élaborée conjointement avec les collectivités et les pratiques respectueuses :
Programme de formation sur le terrain des Inuits (PDF; 731 ko) (en anglais seulement) et le Programme sur l’apprentissage et le perfectionnement des Inuits
Projet pilote de gardiens autochtones (ECCC, RCAANC, MPO, PC, RNCan et AEIC)
Programme Géoscience environnementale (RNCan, Commission géologique du Canada et Savoir polaire Canada) [en anglais seulement]
Établir de nouvelles orientations (IRSC, CRSNG et CRSH)
Te Mana o te Wai (eau douce dirigée par les Māori, propriété des Māori, Nouvelle-Zélande) [en anglais seulement]
Besoins en matière de connaissances et de programmes
Culture et identité
« Sept générations d’enfants autochtones ont été privées de leur identité. Nous avons entendu comment, séparés de leur langue, de leur culture, de leurs traditions spirituelles et de leur histoire collective, les enfants sont devenus incapables de répondre à des questions aussi simples que : D’où est-ce que je viens? Où est-ce que je m’en vais? Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je? » [traduction]
– Juge Murray Sinclair, cérémonies de clôture de la Commission de vérité et réconciliation (juin 2015)
Il existe un besoin urgent de programmes plus souples, de recherches élaborées conjointement avec les collectivités et de formations transformatrices pour promouvoir des pratiques de mobilisation et de consultation respectueuses qui répondent mieux aux besoins actuels et émergents des collectivités inuites, métisses et des Premières Nations et comprennent ces besoins.
La liste suivante présente des besoins clés supplémentaires; elle est conçue pour servir de point de départ à un dialogue constructif.
Principales lacunes et besoins
Il y a un déséquilibre de pouvoir lorsque les employés du gouvernement du Canada travaillent avec les collectivités autochtones. Il est nécessaire de prendre conscience de ce déséquilibre et du contexte historique de ces questions sensibles, par exemple en formant les gestionnaires et les scientifiques à mieux comprendre les perspectives et les besoins uniques des peuples autochtones.
Le Canada a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et les fonctionnaires doivent se familiariser avec les droits et obligations énoncés dans cette déclaration afin d’intégrer ces responsabilités dans leur travail.
L’établissement de relations constructives nécessitera un investissement à long terme, de la souplesse et une volonté de faire les choses différemment. Le passage à une relation plus ouverte, continue et constructive avec les peuples autochtones nécessite la reconnaissance des droits des Autochtones, de la souveraineté des données et du soutien aux objectifs communautaires.
Vérité et réconciliation
Il y a un déséquilibre de pouvoir lorsque les employés du gouvernement du Canada travaillent avec les collectivités autochtones. La prise de conscience de ce déséquilibre et du contexte historique de ces questions sensibles est impérative pour une mobilisation significative des gouvernements et des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis (voir le site Web du Centre national pour la vérité et la réconciliation).
Les gouvernements et collectivités autochtones doivent être abordés avec le même soin et la même considération que pour toute autre relation internationale.
Pour établir des relations fructueuses, les gestionnaires et les scientifiques doivent être formés pour mieux comprendre les perspectives et les besoins particuliers des détenteurs de droits autochtones. Pour les employés en contact direct avec le public, cette formation devrait être obligatoire (voir l’appel no 57 de la Commission de vérité et réconciliation - en anglais seulement).
Le personnel qui collabore avec des partenaires autochtones doit être multiculturel, multidisciplinaire et multilingue, car la langue est profondément ancrée dans la compréhension et l’interprétation des systèmes de savoir autochtone. Les services de traduction et d’interprétation doivent être soutenus pour permettre la mise en commun des connaissances.
Souveraineté des données et accès à l’information
Les institutions et les ministères fédéraux sont légalement tenus de respecter les droits inhérents et constitutionnels des peuples autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, ce qui inclut le droit à la souveraineté des données.
Les scientifiques fédéraux devraient consulter les Nations autochtones ou les organes de gouvernance lorsqu’ils envisagent de publier des données et des informations autochtones et des résultats scientifiques qui reposent sur de telles données et informations.
Le consentement libre, préalable et éclairé doit être recherché concernant la collecte, l’utilisation et la diffusion des données (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO] 2016 (PDF; 901 ko) – en anglais seulement). Le consentement libre, préalable et éclairé est lié au droit à l’autodétermination et est soutenu par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) (PDF; 655 ko) parmi de nombreux autres instruments internationaux.
Toutes les politiques et tous les accords avec les peuples, les collectivités et les gouvernements autochtones doivent respecter les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP®) — le cadre approuvé pour soutenir l’autodétermination de la recherche, de l’information et de la collecte de données lorsqu’on travaille avec des collectivités autochtones. Il convient de noter que les nouvelles politiques, telles que l’énoncé de politique des trois organismes sur l’éthique de la recherche avec les peuples autochtones, ne répondent pas aux normes de PCAP.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de revues de sciences naturelles contenant des directives et indiquant comment publier de manière appropriée des connaissances autochtones ou des informations sur les ressources culturelles (voir Wong et coll., 2020).
Les connaissances traditionnelles font l’objet d’un examen par les pairs. Elles ont été vérifiées par les gardiens du savoir depuis des générations.
Comprendre les droits et la répartition de l’eau
Les droits autochtones sur l’eau doivent être reconnus, protégés et maintenus, comme l’affirment les traités et autres accords.
Les peuples autochtones ont droit à réparation pour les ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou qu’ils occupaient ou utilisaient et qui ont été utilisées ou endommagées sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (voir la DNUDPA).
Respect du droit fondamental à l’autodétermination des peuples autochtones, qui leur permet de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel (par exemple, la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne).
Recherche élaborée conjointement et établissement de relations
Les conseils d’experts fournis aux collectivités et aux gouvernements autochtones doivent être culturellement appropriés, collaboratifs et éthiques.
Les collectivités partenaires doivent pouvoir participer dès le début du processus de recherche élaborée conjointement (par exemple, pendant la conception du projet et la demande de financement).
Les initiatives doivent viser à renforcer les capacités des Nations et des collectivités autochtones.
Les critères de mesure de la santé des écosystèmes ne doivent pas être uniquement tirés de sources non autochtones.
L’obligation d’adaptation, de consultation et d’action de bonne foi doit toujours être appliquée.
La prise de décisions et la gestion des données doivent rester au niveau de la collectivité.
La collecte des données, la sélection des indicateurs et l’interprétation des données recueillies, quel que soit l’intérêt qu’elles présentent pour la collectivité, doivent être menées par les Autochtones. Le suivi communautaire doit être contrôlé par les Autochtones si la collectivité locale est intéressée par cette démarche.
Soutien financier pour la formation des membres de la collectivité vers des aspirations autochtones dans les domaines des STIM devrait être offert systématiquement (par exemple, voir les programmes de formation de la main-d’œuvre environnementale pour les collectivités autochtones — BEAHR).
Il est urgent de disposer d’outils utilisables qui orientent directement les décisions et les politiques. Pour créer ces outils, il faut des innovateurs, des agents de liaison et des partenariats réciproques à long terme (Westwood et coll., 2020).
L’utilisation de noms de lieux autochtones est un acte inhérent de reconnaissance de l’histoire de la relation des peuples autochtones avec la terre et l’eau.
Le fait de faciliter les partenariats à long terme est un moyen de favoriser la sensibilisation et le respect interculturels et de favoriser ces qualités dans la prochaine génération de chercheurs autochtones et non autochtones.
Message à retenir
L’eau est notre ressource la plus précieuse, mais l’eau douce représente moins de 3 % de l’eau à l’échelle mondiale. L’eau saine est essentielle à la vie. Malheureusement, la dégradation de la qualité de l’eau douce est très répandue, et la qualité de l’eau est particulièrement dégradée dans de nombreuses collectivités rurales et autochtones qui continuent d’être soumises à des avis d’ébullition d’eau ou de non‑consommation. On s’attend à ce que les changements climatiques exacerbent ces défis, ce qui entraînera une nouvelle dégradation des ressources en eau douce, ce qui continuera à représenter une menace importante pour la santé de tous les Canadiens et en particulier pour les peuples autochtones.
Remerciements
Le concept original du présent document a été élaboré lors des ateliers de soutien et de sensibilisation des Autochtones de l’été 2020, organisés par le Groupe interministériel fédéral sur les STIM. Un grand merci aux aînés, aux présentateurs, aux participants et aux organisateurs de cette série d’ateliers pour leurs réflexions et leurs commentaires. Nous reconnaissons aussi respectueusement qu’une grande partie de ce texte a été écrite sur le territoire traditionnel non cédé, non soumis, des Wəlastəkw au centre du Nouveau-Brunswick.
Références
Bartlett, C., Marshall, M., et Marshall, A. 2012. Two-Eyed Seeing and other lessons learned within a co-learning journey of bringing together indigenous and mainstream knowledges and ways of knowing. Journal of Environmental Studies and Sciences, 4, pp. 331-340.
Henri, D.A., Brunet, N.D., Dort, H.E., Odame, H.H., Shirley, J., et Gilchrist, H.G. 2020. What is effective research communication? Towards cooperative inquiry with Nunavut communities. Arctic, 73(1), pp. 81-98, 2020.
Horowitz, L.S., Keeling, A., Lévesque, F., Rodon, T., Schott, S., et Thériault, S. 2018. Indigenous Peoples’ relationships to large-scale mining in post/colonial contexts: Toward multidisciplinary comparative perspectives. The Extractive Industries and Society, 5(3), pp. 404-414, 2018.
Cercle autochtone d’experts. Nous nous levons ensemble — Atteindre l’objectif 1 du Canada en créant des aires protégées et de conservation autochtones dans l’esprit et la pratique de la réconciliation (PDF; 4,97 Mo). Rapport et recommandations. 2018. Consulté le 7 août 2020.
Reid, A.J., Eckert, L.E., Lane, J.-F., Young, N., Hinch, S.G., Darimont, C.T., Cooke, S.J., Ban, N.C., et Marshall, A. 2020. “Two-Eyed Seeing”: an Indigenous framework to transform fisheries research and management. Fish and Fisheries, 2022. pp. 243-261.
Turnbull, D. 1997. Reframing science and other local knowledge traditions. Futures, 29(6), pp. 551-562, 1997.
Westwood, A.R., Barker, N.K., Grant, S., Amos, A., Camfield, A.F., Cooper, K., Dénes, F.V., Jean-Gagnon, F., McBlane, L., Schmiegelow, F.K.A., Simpson, J.I., Slattery, S.M., Sleep, D.J.H., Sliwa, S., Wells, J.V., et Whitaker, D.M. 2020. Toward actionable, coproduced research on boreal birds focused on building respectful partnerships. Avian Conservation and Ecology, 15(1), p. 26, 2020.
Wong, P.B., Dyck, M.G., Arviat Hunters and Trappers, Ikajutit Hunters and Trappers, Maykalik Hunters and Trappers, et Murphy, R.W. 2017. Inuit perspectives of polar bear research: lessons for community-based collaborations. Polar Record, 53(270), pp. 257-270, 2017.
Changements climatiques et variabilité du climat
Les changements climatiques continueront d’avoir des répercussions sur les facteurs liés à l’intégrité et à la santé des écosystèmes d’eau douce. Parmi ces répercussions, mentionnons une augmentation de la fréquence des phénomènes hydroclimatiques, des variations dans le bilan hydrique et la disponibilité de l’eau, une détérioration de la qualité de l’eau et des modifications aux écosystèmes aquatiques. La capacité de prévoir avec précision les phénomènes à court terme et de créer des projections à long terme reste limitée. Il est nécessaire de se concentrer davantage et en collaboration sur la synthèse des connaissances scientifiques sur l’eau douce et la mobilisation des connaissances afin de comprendre et d’éclairer la façon dont les changements climatiques toucheront les écosystèmes d’eau douce au Canada.
Auteurs et contributeurs
Phénomènes hydroclimatiques extrêmes (inondations et sécheresses)
Auteurs: Barrie Bonsal1, Yonas Dibike1, Daniel L. Peters1, Rajesh R. Shrestha1, Christopher Spence1, Daqing Yang1, et Eric Boisvert2
1 Environnement et Changement climatique Canada
2 Ressources naturelles Canada, La Commission géologique du Canada
Bilan hydrique, disponibilité de l’eau et durabilité
Auteurs: Christopher Spence1, Barrie Bonsal1, Yonas Dibike1, Daniel L. Peters1, Rajesh R. Shrestha1, et Daqing Yang1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Incidences sur la qualité de l’eau dans un climat en mutation
Auteurs: Andrew Bramburger1, Chris Parsons1, et Thomas Reid1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Phénomènes hydroclimatiques extrêmes (inondations et sécheresses)
Messages clés
Les phénomènes hydroclimatiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses constituent une grave menace pour les ressources en eau douce actuelles et futures et les écosystèmes aquatiques du Canada, entraînant souvent des répercussions considérables sur l’environnement, l’économie et la sécurité publique.
Les changements climatiques peuvent avoir des incidences sur de multiples facteurs qui influent sur les inondations et les sécheresses, mais étant donné la complexité de ces phénomènes, les prévisions à court terme et les projections à long terme des variations de leur fréquence et de leur ampleur au Canada restent incertaines.
Les travaux futurs exigent de poursuivre et d’améliorer la surveillance hydroclimatique dans toutes les régions du Canada, une modélisation couplée climat-hydrologie pour évaluer les changements futurs en matière d’inondation et de sécheresse dans un contexte de réchauffement climatique, de la recherche intégrée de tous les ordres de gouvernement avec le milieu universitaire pour déterminer les incidences environnementales, sociales, économiques et culturelles des futurs phénomènes hydroclimatiques extrêmes.
Résumé
Les changements actuels et futurs aux ressources en eau douce et aux écosystèmes aquatiques du Canada sont fortement influencés par les phénomènes hydroclimatiques extrêmes, à savoir les inondations et les sécheresses, qui agissent à différentes échelles temporelles et spatiales. Les inondations par de l’eau douce découlent principalement de précipitations excessives, de la fonte des neiges, d’embâcles, de la pluie sur la neige ou d’une combinaison de ces facteurs. Bien que l’on s’attende à ce que le réchauffement futur ait une influence sur ces facteurs causant des inondations, il n’est pas facile de déterminer comment ces changements interagiront sur la fréquence et l’ampleur des inondations futures. Selon différents scénarios d’émissions, le climat au Canada devrait se réchauffer en toutes saisons, augmentant ainsi le risque de sécheresse dans un grand nombre de régions au pays. L’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des sécheresses estivales dépend de la capacité des précipitations estivales futures à compenser l’augmentation de l’évaporation et de la transpiration. La diminution de la couche de neige et la fonte hâtive de la neige et de la glace associées au réchauffement pourraient accroître le risque de sécheresse dans les nombreux bassins alimentés par la fonte de la neige au Canada qui dépendent de cette source d’eau, ainsi que dans les régions où l’eau de fonte des glaciers est la principale source d’eau pendant la saison sèche. Les changements climatiques auront donc une incidence sur plusieurs facteurs influant sur les inondations et les sécheresses, mais étant donné la complexité de ces phénomènes, les prévisions à court terme et les projections à long terme restent incertaines. Une meilleure intégration parmi les chercheurs et les programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones, municipaux et universitaires est nécessaire pour déterminer les répercussions environnementales, sociales, économiques et culturelles des futurs phénomènes hydroclimatiques extrêmes et de la disponibilité de l’eau douce qui en découlera.
Principaux besoins et lacunes
Intégrer les modèles climatiques, hydrologiques et de qualité de l’eau à l’échelle mondiale et régionale. Il faut intensifier la recherche pour améliorer l’intégration des modèles climatiques et météorologiques mondiaux et régionaux aux modèles hydrologiques et de qualité de l’eau répartis en surface et sous la surface, afin de mieux comprendre, prévoir et projeter les effets du réchauffement climatique sur les futurs phénomènes hydroclimatiques extrêmes ainsi que leurs incidences sur l’eau douce.
Renforcer les mesures de résilience par la recherche sur les risques d’inondation. Il faut de la recherche sur les effets des changements climatiques sur les risques futurs d’inondation en raison de l’évolution de facteurs combinés tels que les épisodes de précipitations extrêmes de courte durée et à plus grande échelle, avec des crues printanières plus complexes, afin d’orienter les mesures de résilience dans l’environnement bâti et d’améliorer l’état de préparation aux situations d’urgence.
Améliorer l’état des connaissances sur les sécheresses en saisons chaudes et froides. De la recherche sur les incidences du réchauffement climatique sur la fréquence, l’intensité, la durée, l’étendue spatiale, l’apparition et la fin des sécheresses en saisons chaudes et froides et sur les niveaux d’eau associés est nécessaire pour mieux orienter les approches de gestion adaptative comme les modèles de scénarios futurs, les approches de réduction d’échelle et les modèles de cultures agricoles.
Bilan hydrique, disponibilité de l’eau et durabilité
Messages clés
Le Canada dispose de ressources en eau douce relativement importantes, mais la quasi-totalité du pays est exposée à divers facteurs de stress liés à la disponibilité de l’eau, dont les changements climatiques. Cette situation met constamment en danger le milieu aquatique, ce qui se répercute sur la santé humaine et les activités sociales, culturelles et économiques.
Les variables du bilan hydrique changent dans tout le pays en réaction à la hausse des températures. Certains signes clairs apparaissent, notamment la diminution rapide de la cryosphère (neige, glaciers, glace et pergélisol), la modification des régimes de précipitations et la prolongation de la période où le sol n’est pas recouvert de neige, ce qui entraîne une augmentation de l’évaporation.
En raison du réchauffement prévu, les variations et tendances importantes modifiant le bilan hydrique vont se poursuivre. Cependant, les réactions, notamment en ce qui concerne le débit des cours d’eau et le niveau des plans d’eau, seront complexes et variables dans l’ensemble des paysages et des bassins hydrographiques du Canada.
Résumé
Le Canada dispose de ressources en eau douce relativement importantes, mais la disponibilité de l’eau douce varie considérablement dans le pays selon la période et en matière de quantité. Les variations du bilan hydrique attribuables aux changements climatiques ont déjà et continueront d’avoir des répercussions sur la disponibilité de l’eau douce, ce qui crée des difficultés et augmente la vulnérabilité de nos systèmes de gestion hydrique. La disponibilité de l’eau douce est régie par les processus du cycle de l’eau, dont l’importance varie considérablement selon les différents paysages et bassins hydrographiques. Bien qu’il n’y ait pas eu d’évaluation pancanadienne uniforme de la disponibilité future de l’eau, il existe de nombreuses données sur l’évolution du bilan hydrique dans la majeure partie du Canada. La diminution de la cryosphère est répandue. Les changements de phase des précipitations (la neige qui tombe maintenant sous forme de pluie) sont de plus en plus fréquents en automne, en hiver et au printemps. Les périodes d’enneigement plus courtes se traduisent par des périodes d’évaporation plus longues et des volumes d’évaporation plus importants. La disponibilité de l’eau dans les cours d’eau, les plans d’eau et les milieux humides va donc changer. La manifestation de ces changements est complexe, car elle varie fortement en fonction du paysage, de la taille du bassin hydrographique, des infrastructures bâties et de la période en question. L’adaptation à ces types de changements nécessite de recourir à une analyse et à une modélisation fondées sur les meilleures données disponibles en matière de bilan hydrique. La nature transfrontalière d’une grande partie de l’eau douce du Canada exige un meilleur travail d’équipe intergouvernemental en matière de recherche sur l’eau et de prévisions hydriques. La mobilisation de tous les partenaires, bénéficiaires et intervenants clés permet d’obtenir des résultats plus significatifs en gestion de l’eau et une meilleure résilience des communautés.
Principaux besoins et lacunes
Faire de la recherche sur les processus du bilan hydrique à l’échelle nationale. Il est nécessaire de faire de la recherche sur les principaux processus du bilan hydrique ainsi que d’examiner les variations projetées du débit des cours d’eau et de la disponibilité de l’eau douce à l’échelle nationale. Ces connaissances doivent être intégrées plus efficacement aux systèmes de prévision environnementale afin d’améliorer les projections de la disponibilité de l’eau et de la vulnérabilité, et de réduire l’incertitude lors de la prise de décision.
Surveiller les variables hydroclimatiques. Il faut améliorer la collecte de données hydroclimatiques de haute qualité pour une analyse approfondie et une modélisation avancée afin de mieux comprendre et prévoir les processus du cycle de l’eau exposés aux variations des bilans hydriques et à la disponibilité de l’eau, ainsi que pour favoriser la coordination avec les modèles de gestion de l’eau, p. ex., pour mieux connaître les effets de l’exploitation des ressources sur la qualité et la quantité de l’eau.
Accroître la capacité d’améliorer et de coordonner les méthodes d’observation de la Terre comme norme. Il est nécessaire de réaliser des progrès dans la coordination des méthodes d’observation de la Terre pour récupérer les variables relatives à l’état hydrique et au flux et débit de l’eau dans les systèmes de prévision environnementale pour faciliter l’assimilation de l’hydrologie définie sur le terrain, dans les modèles et par télédétection. Ces progrès permettront de mieux comprendre la disponibilité de l’eau douce au Canada.
Incidences sur la qualité de l’eau dans un climat en mutation
Messages clés
Les variations de la température de l’eau, de la stratification, de la couverture de glace et des précipitations, associées aux changements climatiques anthropiques, ont des incidences sur les processus physiques, chimiques et biologiques qui déterminent la qualité de l’eau dans les systèmes d’eau douce, comme sur la présence de sédiments en suspension, de nutriments et de contaminants ainsi que de l’hypoxie.
En raison de leur position géographique et de leur répartition, les écosystèmes d’eau douce du Canada comptent parmi les masses d’eau qui varient le plus rapidement et qui sont les plus sensibles sur la planète. Les lacs en milieu de pergélisol, les lacs froids monomictiques et les lacs dimictiques approchent de points de rupture qui pourraient modifier radicalement les processus biogéochimiques, ce qui aurait des conséquences imprévisibles sur la qualité de l’eau, la santé des écosystèmes et les utilisations bénéfiques.
La détérioration de la qualité de l’eau a des répercussions importantes sur la santé humaine et les services écosystémiques. L’altération de la qualité de l’eau est liée à la fois à des atteintes directes (p. ex., consommation, loisirs et esthétique) et indirectes (p. ex., perturbation de l’habitat et consommation de poissons et d’animaux sauvages) et à l’utilisation humaine, en plus d’avoir des effets négatifs sur l’adéquation de l’habitat pour la faune.
Résumé
Les changements climatiques modifient la température de l’eau, la stratification des lacs et la couverture de glace, ainsi que les régimes de précipitations. Dans les systèmes d’eau douce, ces facteurs de stress influent sur les processus physiques, chimiques et biologiques qui sont liés à la qualité de l’eau, notamment le dégel du pergélisol et la formation de lacs thermokarstiques, la remobilisation de nutriments anciens (phosphore), la brunification (augmentation de la charge en matières organiques dissoutes dans l’eau), l’eutrophisation et la prolifération associée d’algues nuisibles. Ces changements ont une incidence continue sur la santé humaine et les services écosystémiques. Il est nécessaire d’élaborer une approche globale et coordonnée pour quantifier la qualité de l’eau à l’échelle nationale, ainsi que de faire de la recherche sur la réaction généralisée à l’évolution des communautés et aux modifications subséquentes des voies de transport des matières et de l’énergie dans les réseaux trophiques aquatiques (p. ex., la modification de la dynamique des nutriments, du carbone et des contaminants). À plus long terme, il faudra élaborer des mécanismes coordonnés à l’échelle nationale pour quantifier les effets des changements climatiques sur la qualité de l’eau des écosystèmes aquatiques à l’échelle régionale et nationale, et notamment mettre conjointement au point des pratiques de collecte de données pour obtenir simultanément des informations utiles sur le climat et la qualité de l’eau.
Principaux besoins et lacunes
Réaliser un inventaire national des écosystèmes d’eau douce et le tenir à jour. Un inventaire national des ressources en eau douce qui caractérise la géologie, l’hydrologie ainsi que la qualité de l’eau de référence pour les principaux systèmes de bassins hydrographiques est nécessaire pour mieux quantifier les variations attribuables aux facteurs climatiques et faciliter la communication et la collaboration entre les gouvernements, le milieu universitaire et les intervenants.
Intégrer les modèles climatiques pour prendre en compte la santé des écosystèmes aquatiques. Il est nécessaire d’élaborer des modèles climatiques, hydrologiques, déterministes et statistiques, améliorés et coordonnés, qui prennent en compte la qualité de l’eau et la biodiversité des écosystèmes aquatiques (p. ex., modélisation du réseau trophique) afin de tenir compte de toutes les interactions qui se produisent dans un écosystème d’eau douce et qui pourraient mettre en évidence pourquoi et comment les décisions relatives au climat et à l’utilisation des terres ont une incidence sur les régimes hydrologiques et de brassage des lacs.
Assurer la poursuite des études à long terme sur l’eau douce. Des investissements permanents dans la recherche fondamentale et mécaniste entre les facteurs environnementaux et les réactions des biotes (à l’échelle moléculaire, métabolique et environnementale) qui régulent la qualité de l’eau à diverses échelles spatiales sont nécessaires pour répondre efficacement aux questions complexes concernant la compréhension relative aux prévisions sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques au Canada et pour orienter l’élaboration de mesures de gestion efficaces et prises rapidement.
Utilisation des terres
Les changements dans l’utilisation des terres et de l’eau, notamment pour l’agriculture ou l’urbanisation, ont des répercussions importantes sur la quantité et sur la qualité de l’eau douce au Canada. Ces répercussions sont principalement dues à l’augmentation de la demande en eau et à l’introduction de nutriments en excès dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines, ce qui nuit aux écosystèmes aquatiques partout au Canada. Dans le contexte des changements climatiques, les écosystèmes d’eau douce continueront d’être affectés par les fluctuations de la disponibilité de l’eau, ainsi que par les engrais, les pesticides, les eaux usées et d’autres effluents qui pénètrent dans les masses d’eau par ruissellement.
Un large éventail d’activités humaines entraîne des répercussions importantes sur la santé et l’intégrité des écosystèmes d’eau douce, notamment l’agriculture, les espèces aquatiques envahissantes, l’hydroélectricité, l’aquaculture, l’habitat du poisson, la foresterie, l’exploitation minière et l’utilisation de l’eau souterraine. Des activités accrues de recherche interdisciplinaire dans ces domaines, qui éclairent la prise de décision en matière d’utilisation durable des terres et d’activités anthropiques, garantiront la résilience des écosystèmes d’eau douce au Canada pour les générations futures.
Auteurs et contributeurs
Facteurs de stress d’origine Agricole
Auteurs: Andrew Davidson1, Chris Jordan1, John Eden1, Christine Bissonnette1, Yves Arcand1, Shabtai Bittman1, Michel Britten1, Catherine Champagne1, Bahram Daneshfar1, Samantha David1, Evan Derdall1, Craig Drury1, Patrick Handyside1, Steve Javorek1, Yefang Jiang1, Pamela Joosse1, Sheng Li1, Emily McAuley1, Heather McNairn1, Dan MacDonald1, Anna Pacheco1, Jarrett Powers1, Keith Reid1, Erin Smith1, Ed Topp1, Jason Vanrobaeys1, Sébastien Villeneuve1, Henry Wilson1, and Jingyi Yang1
1 Agriculture et Agroalimentaire Canada
Espèces aquatiques envahissantes
Auteurs: Sophie Foster1 et Stephanie Sardelis1
1 Pêches et Océans Canada
Facteurs de stress liés à l’hydroélectricité
Auteurs: Karen E. Smokorowski1
1 Pêches et Océans Canada
Facteurs de stress liés à l’aquaculture
Auteurs: Ingrid Burgetz1 et Doug Geiling1
1 Pêches et Océans Canada
Habitat des poissons d’eau douce
Auteurs: Karin Ponader1 et Lynn Bouvier1
1 Pêches et Océans Canada
Évolution des forêts
Auteurs: Jason Leach1 et Erik Emilson1
1 Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Métaux et minerais
Auteurs: Carrie J. Rickwood1 et Konstantin Volchek1
1 Ressources naturelles Canada, CanmetMINING
Consommation d’eau souterraine
Auteurs: Eric Boisvert1, Steve Grasby1, Christine Rivard1, Melissa Bunn1, Marc H. Hinton1, Alexandre Desbarats1, et Hazen Russell1
1 Ressources naturelles Canada, La Commission géologique du Canada
Facteurs de stress d’origine agricole
Messages clés
On s’attend à ce que les changements climatiques accentuent les enjeux de quantité et de qualité de l’eau dans le secteur agricole canadien. La recherche sur l’irrigation et le drainage, ainsi que sur l’utilisation d’engrais et de pesticides, assurera la résilience et la productivité tout en améliorant la protection des écosystèmes d’eau douce.
Les enjeux sur la quantité de l’eau comprennent les répercussions des inondations et des sécheresses sur les terres agricoles et les terres environnantes. Au Canada, la consommation d’eau douce en agriculture représente environ la moitié de celle du pays, pour plus d’un million d’hectares de terres irriguées. La recherche, comme l’estimation des seuils, permettrait d’orienter l’élaboration de pratiques agricoles exemplaires vers la bonne application, au bon endroit et au bon moment.
Les enjeux sur la qualité de l’eau portent surtout encore sur les répercussions des engrais et des pesticides, qui sont plus particulièrement préoccupants sur le plan des voies de perte de l’azote et du phosphore des terres agricoles vers les eaux de surface et les eaux souterraines. Mieux comprendre les mécanismes biophysiques expliquant ces phénomènes climatiques extrêmes permettra d’améliorer les pratiques exemplaires de gestion visant à atténuer ces enjeux sur la qualité de l’eau.
Résumé
Les activités relatives aux terres agricoles ont des répercussions sur la qualité et la quantité de l’eau, ainsi que sur la santé des écosystèmes aquatiques au Canada. Les changements climatiques exacerberont ces répercussions. Dans l’agriculture au Canada, les enjeux associés à la qualité de l’eau sont principalement liés aux répercussions de l’utilisation des engrais et des pesticides sur la qualité de l’eau, tandis que ceux associés à la quantité d’eau sont liés à l’excessive rareté (sécheresse) et abondance (inondation) de cette ressource. L’augmentation liée aux épisodes de précipitations extrêmes, due aux changements climatiques, entraîne une augmentation des pertes par lessivage lorsqu’il y a des précipitations fortes après l’épandage d’engrais et avant l’importante absorption par les plantes cultivées. En revanche, les longs épisodes de sécheresse plus graves limitent la croissance des plantes de culture et l’absorption des nutriments par ces plantes, dans les champs où l’azote et le phosphore résiduels en excès sont lessivés, après la récolte, par les pluies d’automne ou du printemps. Il faut renforcer la recherche pour cartographier les champs irrigués, déterminer la variabilité spatiale de l’érosion des sols, définir les scénarios de gestion des effets des nutriments, évaluer la production intensive en serre, étudier les interactions des systèmes d’exploitation agricole à l’échelle du bassin hydrographique et élaborer des pratiques exemplaires de gestion. Il faut également des données produites à l’échelle du producteur, représentant les champs irrigués à l’échelle nationale, et une intensification du recours aux flux de données d’observation de la Terre, actuels et nouveaux. Les réseaux nationaux de surveillance de l’irrigation à partir de l’espace, l’établissement d’un ordre de priorité pour les grands plans d’eau et la communication et la coordination des données sont essentiels. À plus long terme, une meilleure coordination des ministères fédéraux dans le contexte du continuum de l’eau, assurée par des comités scientifiques axés sur les bassins hydrographiques régionaux, un renforcement de la recherche coordonnée avec les intervenants et l’établissement de relations avec les partenaires autochtones pourraient être plus efficaces pour définir ces besoins et y répondre.
Principales lacunes et principaux besoins
S’appuyer sur les connaissances en matière d’érosion des sols pour améliorer les pratiques exemplaires de gestion. Une connaissance approfondie de la variabilité spatiale de l’érosion à l’échelle du bassin hydrographique et du paysage, notamment les interactions entre les processus comme les changements à l’utilisation des terres, l’érosion éolienne et en chenaux, et l’accumulation de sol, est nécessaire pour mieux connaître les effets de la mise en application des pratiques exemplaires de gestion sur ces processus.
S’appuyer sur les connaissances en matière de qualité de l’eau pour améliorer les pratiques exemplaires de gestion. Une connaissance approfondie des effets de l’application des pratiques exemplaires de gestion actuelles sur la qualité de l’eau à l’échelle du bassin hydrographique est nécessaire pour garantir et améliorer l’opportunité et l’efficacité de ces pratiques sur la gestion des nutriments et la protection des écosystèmes aquatiques.
Exploiter les technologies d’observation de la Terre. L’adoption et l’utilisation uniforme des technologies d’observation de la Terre et d’autres données pour créer des cartes annuelles précises des champs irrigués sont nécessaires pour mieux comprendre les tendances spatio-temporelles des changements et de la dynamique des paysages agricoles irrigués du Canada, ce qui contribuera finalement à éclairer davantage la mise au point d’outils d’aide à la décision et de pratiques exemplaires de gestion.
Espèces aquatiques envahissantes
Messages clés
Les espèces aquatiques envahissantes ont des effets importants et coûteux sur les écosystèmes et la santé économique du Canada en raison de leurs répercussions sur les habitats aquatiques, notamment la destruction de l’habitat et la perturbation du réseau trophique.
Les évaluations scientifiques des risques axées sur la prévention et sur la détection hâtive des espèces aquatiques envahissantes demeurent une approche stratégique d’atténuation des coûts environnementaux et économiques futurs. Les outils nouveaux et à venir, tels que ceux faisant appel à l’ADN environnemental (ADNe), sont essentiels et rentables pour la détection hâtive des espèces aquatiques envahissantes.
Les travaux scientifiques visant à permettre aux décideurs d’approfondir leurs connaissances sur les espèces aquatiques envahissantes nécessitent des données et des renseignements provenant de multiples sources, et reposent sur les travaux de collaborateurs importants et une coordination avec un éventail d’expertises.
Résumé
Les espèces aquatiques envahissantes sont l’une des principales causes d’extinction à l’échelle mondiale, et l’une des menaces croissantes les plus importantes et les plus rapides à la sécurité alimentaire, à la santé humaine et animale, et à la biodiversité. Elles contribuent de manière significative aux effets cumulatifs et aux facteurs de stress multiples, notamment la destruction des habitats (déjà touchés par la perte d’habitat), le ruissellement urbain et les eaux usées. Les espèces aquatiques envahissantes sont responsables de la transformation et de la détérioration des milieux humides intérieurs et côtiers, ayant des répercussions sur la structure physique de l’habitat et sur la dynamique du réseau trophique. En outre, selon certaines données, des espèces envahissantes seraient les hôtes de parasites qui peuvent nuire aux espèces indigènes ou les tuer. Les changements climatiques continueront à modifier l’étendue et l’abondance de ces effets. Les mesures de prévention et de détection hâtive sont plus économiques et efficaces que les mesures de lutte et la gestion à long terme, une fois que les espèces aquatiques envahissantes sont établies. Les travaux en cours portent notamment sur la mise au point d’évaluations des risques liés aux espèces et aux voies d’invasion, ainsi que d’outils, et sur la recherche, les conseils scientifiques, les recommandations et le soutien analytique en matière d’outils de détection comme l’ADNe, c.-à-d. l’analyse de l’ADN d’échantillons prélevés dans l’environnement, p. ex., l’eau, pour déduire la présence d’une espèce. Les questions de recherche liées aux espèces aquatiques envahissantes sont multidisciplinaires et nécessitent le soutien et la contribution d’un éventail de sources.
Principales lacunes et principaux besoins
Mobiliser les connaissances scientifiques pour améliorer les mesures de prévention. Il faut continuer à se concentrer sur l’évaluation des risques liés à l’introduction possible d’organismes au Canada, y compris sur les risques liés aux espèces et aux voies d’introduction dans le contexte des changements climatiques, afin d’analyser, de communiquer et d’atténuer efficacement les risques liés aux espèces pouvant être envahissantes.
Favoriser l’utilisation normalisée d’outils modernes comme l’ADNe. Des outils tels que les analyses d’ADN environnemental (ADNe), les recommandations et les normes harmonisées, et les laboratoires agréés d’analyse d’ADNe ou d’analyse judiciaire sont nécessaires pour favoriser une détection hâtive, économique et rapide ainsi que des interventions de gestion.
Facteurs de stress liés à l’hydroélectricité
Messages clés
Le Canada dépend de l’hydroélectricité pour son approvisionnement en électricité et cette dépendance devrait s’accroître avec le temps. Toutefois, la production d’hydroélectricité entraîne des coûts environnementaux en amont et en aval du barrage, ainsi que des répercussions sur les poissons qui tentent de franchir le barrage dans les deux sens.
À l’échelle nationale, la coordination de la recherche qui porte sur l’atténuation des répercussions des barrages hydroélectriques sur l’environnement, notamment par l’élaboration et la validation d’approches novatrices visant à réduire les répercussions sur les poissons qui franchissent les barrages pour se déplacer vers l’amont ou l’aval, permettrait de s’assurer de pouvoir traiter efficacement les problèmes et les questions complémentaires à des échelles plus larges.
Résumé
La production d’hydroélectricité est essentielle à l’approvisionnement énergétique du Canada, mais le harnachement des cours d’eau a souvent des conséquences. La transformation d’habitats fluviaux en habitats lacustres (réservoirs) en amont des barrages peut modifier le régime d’écoulement, l’habitat disponible, la dynamique thermique et la qualité de l’eau. Les répercussions en amont comprennent également des changements dans la composition des espèces aquatiques, qui s’accompagnent souvent de la perte d’espèces ayant besoin d’un habitat fluvial pour réaliser leur cycle de vie. En outre, la bioaccumulation de contaminants comme le mercure, causée par l’inondation de milieux secs pour la création du réservoir, demeure une préoccupation, en particulier dans les régions boréales. L’échelle et l’ampleur des répercussions en aval varient de façon importante, et sont influencées par la taille et la configuration du barrage, le régime opérationnel de l’installation en tant que telle et le degré de modification issu du régime d’écoulement naturel. La fragmentation des cours d’eau affecte la connectivité des habitats, ce qui a une incidence à la fois sur les espèces résidantes et les espèces migratrices de poissons, qui dépendent de l’accès aux habitats en amont pour frayer, et cause des blessures ou la mort chez les poissons qui franchissent le barrage lorsqu’ils se déplacent vers l’aval. On comprend de mieux en mieux comment la production d’hydroélectricité peut affecter le biote et l’habitat aquatiques, et les mesures d’atténuation possibles pour réduire ces répercussions. Pour mieux atténuer les répercussions de la production d’hydroélectricité sur la biodiversité et sur les habitats aquatiques, un effort axé sur les nouvelles technologies, notamment les microcentrales hydroélectriques ou les turbines hydrocinétiques, présente un bon potentiel, même s’il faut encore mieux comprendre tous les effets cumulatifs possibles découlant de la présence de nombreuses petites installations au lieu d’un grand barrage. La recherche de solutions d’atténuation innovantes pour les installations actuelles et nouvelles mérite une attention particulière. À plus long terme, la recherche bénéficierait grandement d’une coordination nationale permettant d’aborder des questions complémentaires à des échelles plus larges, ce qui pourrait apporter des solutions au-delà des sites spécifiques. Une mobilisation des connaissances axée sur l’utilisateur augmenterait considérablement la valeur des travaux de recherche considérables effectués par l’industrie et ses experts-conseils à des fins de régulation propre à un site.
Principales lacunes et principaux besoins
Favoriser une technologie modernisée de l’hydroélectricité. De la recherche et des évaluations sur les nouvelles technologies telles que les microcentrales hydroélectriques et les turbines hydrocinétiques sont nécessaires pour réduire le stress causé par les barrages sur la santé des écosystèmes aquatiques.
Trouver des techniques innovantes d’atténuation. La mise au point et la validation de techniques d’atténuation innovantes utilisées sur les incidences du déplacement des poissons vers l’amont, vers l’aval et par la passe à poissons sont nécessaires pour éclairer le choix des mesures, comme une réglementation propre au site ou plus générale.
Faciliter la coordination nationale et plurigouvernementale. Une approche plurigouvernementale coordonnée visant à mettre en relation et à mobiliser la recherche et les connaissances sur les questions communes de durabilité liées à l’hydroélectricité et aux répercussions sur la santé des écosystèmes aquatiques est nécessaire pour améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures, outre les approches caractéristiques propres au lieu ou propres au site touchant les répercussions et les mesures d’atténuation.
Facteurs de stress liés à l’aquaculture
Messages clés
À l’échelle mondiale, près de 50 % de l’approvisionnement en poissons destinés à la consommation humaine provient désormais de l’aquaculture et ce pourcentage va continuer à augmenter. La majorité de l’aquaculture canadienne de poissons d’eau douce se fait en parcs en filet ouverts dans de grands plans d’eau, principalement dans le lac Huron et dans le lac Diefenbaker, mais aussi en Colombie-Britannique et, depuis peu, dans le lac Supérieur.
Les déchets de l’aquaculture (y compris les excrétions, les éjections et, dans une moindre mesure, les aliments non consommés) apportent des nutriments aux plans d’eau qui accueillent cette activité, et réduisent la quantité d’oxygène dissous dans les sédiments et au-dessus, ce qui entraîne des effets très localisés, surtout dans la zone benthique.
La recherche du passé et en cours était axée sur les interactions entre la qualité de l’eau et celle des sédiments, ainsi qu’avec celle du biote benthique, à l’échelle du lieu de pisciculture. La recherche future sera de recenser les effets cumulatifs dans les milieux ambiants, afin de mieux éclairer la régulation à l’échelle de la baie et du lac.
Résumé
À l’heure actuelle, les gens consomment plus de poissons et de produits de la pêche que ce que peuvent fournir les sources naturelles. L’aquaculture en eau douce soutient l’élevage de truites arc-en-ciel et une augmentation de la production est nécessaire pour répondre à la demande actuelle. Les aliments pour consommation animale utilisés en aquaculture augmentent les concentrations de phosphore (ce qui contribue à la présence de nutriments en excès dans les milieux d’eau douce) et réduisent la quantité d’oxygène dissous dans les sédiments et juste au-dessus des sédiments de plans d’eau hôtes. Des effets très localisés, surtout dans la zone benthique, ont été constatés, mais aucune répercussion à grande échelle sur l’environnement n’a été observée jusqu’à présent. Les zones halo de l’enrichissement léger en nutriments dans la zone benthique semblent s’étendre au-delà de ce que les modèles de dépôt auraient prévu. Cependant, les répercussions écosystémiques de l’enrichissement en nutriments benthiques dans différents systèmes d’eau douce canadiens ne sont pas bien caractérisées ni bien comprises. Les installations aquacoles en bassins fermés rejettent également des effluents qui ont des effets sur les écosystèmes aquatiques. Plusieurs entités fédérales ont la responsabilité commune de réglementer les activités aquacoles, et divers travaux de recherche gouvernementaux et universitaires sont en cours pour déterminer les répercussions sur les milieux d’eau douce au Canada.
Principales lacunes et principaux besoins
Mener une recherche sur les effets de l’enrichissement en nutriments dans les sites de pisciculture environnants. La recherche sur les effets de l’enrichissement en nutriments autour des sites de pisciculture, comme la caractérisation de la dynamique propre au site, les effets des variations dans la formulation des aliments destinés à la consommation animale sur la zone benthique et la productivité primaire dans les eaux environnantes sont nécessaires pour éclairer le choix des mesures d’atténuation et la prise de décision en fonction de l’augmentation continue de la production de ces sites d’élevage.
Mener une recherche sur les effets en champ lointain et les effets cumulatifs. Une recherche sur les effets en champ lointain et les effets cumulatifs pour examiner la capacité de charge des plans d’eau est nécessaire pour soutenir la durabilité de l’environnement et mieux éclairer le choix d’emplacement des futurs aménagements au fur et à mesure de l’expansion de l’industrie aquacole.
Habitat des poissons d’eau douce
Messages clés
L’habitat des poissons d’eau douce a une valeur environnementale, économique, culturelle et spirituelle pour tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones. Les menaces les plus pressantes pour la santé de cet habitat sont sa détérioration et sa modification, la présence d’espèces aquatiques envahissantes, la pollution et les changements climatiques, tandis que les nouveaux enjeux concernent les effets cumulatifs et la résilience des écosystèmes.
L’étude des effets cumulatifs et l’efficacité des mesures de gestion de l’habitat, l’élaboration de normes nationales cohérentes en matière de collecte des données et de surveillance relatives à l’habitat d’eau douce, ainsi que la communication, à l’échelle nationale, des données, des renseignements sur l’habitat et des conseils scientifiques qui en découlent, grâce à des plateformes accessibles au public, sont toutes essentielles pour répondre aux besoins des intervenants et des utilisateurs.
Résumé
L’habitat des poissons d’eau douce a une valeur environnementale, économique, culturelle et spirituelle pour tous les Canadiens, notamment les peuples autochtones. La détérioration de l’habitat et sa modification, les espèces aquatiques envahissantes, les effets nocifs de la pollution et les changements climatiques sont des menaces permanentes à l’habitat des poissons d’eau douce. Des études scientifiques robustes et collaboratives sur l’habitat d’eau douce sont nécessaires pour l’élaboration de politiques, la prise de décisions réglementaires et la mise au point d’outils opérationnels pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les pêches (2019) modifiée et modernisée. Dey et coll. (2021) ont réalisé une étude exhaustive qui visait à répondre en priorité aux questions de recherche sur l’habitat d’eau douce et ont constaté que de la recherche est nécessaire pour mieux comprendre les répercussions de chacun des facteurs de stress et des effets cumulatifs des activités humaines sur les habitats d’eau douce. En outre, il faut évaluer l’efficacité des mesures de gestion des habitats pour améliorer davantage la conservation et la protection de l’habitat du poisson dans toutes les provinces et tous les territoires. Pour coordonner efficacement les activités scientifiques dans l’ensemble du Canada et s’assurer que les données sont mises à la disposition du public, une approche normalisée de collecte de données sur les habitats d’eau douce et de surveillance de ces habitats est nécessaire.
Principales lacunes et principaux besoins
Exploiter les connaissances actuelles et mieux comprendre les effets cumulatifs. Des recherches collaboratives sur les répercussions de chacun des facteurs de stress, les effets cumulatifs des activités humaines sur les poissons d’eau douce et leur habitat, et l’efficacité des mesures de gestion de l’habitat sont nécessaires pour mieux éclairer l’élaboration de politiques ainsi que la prise de décisions réglementaires et de décisions de gestion.
Normaliser, à l’échelle nationale, les méthodes de collecte de données sur les habitats d’eau douce, ainsi que les approches d’analyse de ces données et de surveillance de ces habitats. L’élaboration d’une approche cohésive, cohérente et coordonnée à l’échelle nationale pour la collecte et l’analyse des données sur les habitats d’eau douce, ainsi que de normes nationales pour la surveillance des habitats d’eau douce, est nécessaires pour la prise de décisions de gestion éclairées et fondées sur des données probantes et pour l’amélioration de l’évaluation exhaustive de l’efficacité des mesures de gestion des habitats.
Rendre les données découvrables et accessibles au public. Il est nécessaire de renforcer les efforts visant à rendre les données sur les habitats d’eau douce accessibles aux scientifiques, aux organismes de réglementation et au public par l’accès à des plateformes de bases de données ouvertes, qu’elles soient récentes ou nouvelles, afin de soutenir la recherche sur les habitats d’eau douce et la coordination des efforts de conservation et de protection des poissons et de leurs habitats.
Évolution des forêts
Messages clés
Les forêts représentent une grande partie du paysage canadien et constituent une source essentielle d’eau douce.
Les changements climatiques, les incendies de forêt, l’urbanisation et l’extraction des ressources modifient les forêts d’une manière sans précédent, ce qui a des répercussions sur la sécurité de l’eau douce.
Le Canada peut exploiter les forêts en tant que solution naturelle pour améliorer la sécurité de l’eau douce dans un monde en mutation.
Résumé
Les forêts représentent une grande partie du paysage canadien et constituent une source essentielle d’eau douce. Les forêts jouent un rôle important dans l’atténuation des risques d’inondation et de sécheresse, l’approvisionnement en eau potable et le maintien de l’habitat aquatique et de la biodiversité. Les forêts subissent les effets d’une série de facteurs de stress naturels et anthropiques tels que les changements climatiques, les incendies de forêt, le déboisement et l’exploitation forestière, ce qui entraîne des conséquences sur l’eau douce. Il est nécessaire de mieux comprendre la manière dont les forêts changent, ainsi que les conséquences de ces changements sur l’approvisionnement en eau douce, l’habitat et la biodiversité. Pour aller de l’avant, il est nécessaire d’apporter un soutien coordonné afin de faire progresser la science sur les interactions entre la forêt et l’eau, et ainsi de répondre aux problèmes actuels et émergents. Le fait de se concentrer sur l’établissement d’un dialogue et d’une collaboration entre les communautés autochtones avec les scientifiques, les gestionnaires et les intervenants en matière de forêt et d’eau permettrait d’élaborer une stratégie nationale sur la gestion de la forêt et de l’eau. En outre, la plupart des connaissances sur les systèmes forêt-eau proviennent de petits bassins hydrographiques expérimentaux ou consistent en de courts documents de données qui ne reflètent pas les changements à long terme dans la dynamique des forêts et du climat. Une approche coordonnée à l’échelle nationale pour la surveillance des systèmes forêt-eau, en particulier aux échelles utiles pour la gestion, permettrait de mieux comprendre et de prévoir des stratégies de gestion fondées sur la science, afin de garantir la pérennité de l’eau douce d’origine forestière dans un monde en constante évolution. Compte tenu de l’étendue du couvert forestier au Canada, il est possible de tirer parti des forêts et de les gérer en tant que solutions axées sur la nature pour améliorer la sécurité de l’eau douce dans un contexte de changements climatiques.
Principales lacunes et principaux besoins
Étudier la répercussion des changements forestiers sur les ressources en eau douce et les habitats aquatiques. Compte tenu de l’influence répandue des forêts sur le cycle de l’eau au Canada, il est nécessaire de mieux comprendre les répercussions des changements forestiers sur les ressources en eau douce (y compris la prévision des répercussions sur l’approvisionnement en eau potable, les risques d’inondation et de sécheresse, les cycles mondiaux du carbone et la santé des écosystèmes aquatiques et terrestres), afin d’éclairer les travaux d’adaptation et d’atténuation.
Surveiller, de façon coordonnée dans l’ensemble du pays, des systèmes forêt-eau à des échelles utiles pour la gestion. Une approche de surveillance nationale intégrée qui saisit les changements à long terme dans les interactions forêt-eau et à différentes échelles du bassin hydrographique est nécessaire pour construire des modèles robustes permettant de prévoir les conditions futures.
Métaux et minerais
Messages clés
L’industrie des mines de métaux est l’un des principaux consommateurs d’eau douce au Canada : elle représente 11 % du total de la consommation industrielle d’eau potable. Les progrès technologiques visant à réduire l’utilisation de l’eau, à la recycler et à la traiter sont essentiels au développement d’une industrie minière métallique durable au Canada.
L’évaluation des répercussions et des risques associés aux activités minières sur les bassins hydrographiques repose en grande partie sur la compréhension du devenir (p. ex., solubilité et répartition) et des effets des métaux dans les milieux aquatiques. Cependant, il existe des lacunes importantes dans les données pour certains secteurs miniers (p. ex., les minéraux critiques).
Les changements climatiques présentent des risques importants pour les activités minières, comme la réduction des quantités d’eau et la détérioration de la qualité de l’eau, ainsi que des risques pour les infrastructures minières. Il est essentiel de comprendre les répercussions des changements climatiques sur les activités minières pour maintenir la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de l’exploitation responsable des ressources.
Résumé
L’industrie minière a amélioré les technologies d’extraction, de traitement et d’épuration, mais elle dépend encore largement de l’eau. Par conséquent, la consommation et le rejet d’eau par l’industrie minière (p. ex., les effluents des bassins de décantation) augmentent le stress sur les milieux d’eau douce environnants. Les sources de contamination de l’eau douce par l’exploitation minière comprennent les sources ponctuelles (p. ex., les effluents miniers) et les sources non ponctuelles (comme le drainage minier acide, les émissions de poussières et les déversements accidentels). L’industrie minière est réglementée à la fois aux niveaux provincial et territorial, et au niveau fédéral. À titre d’exemple, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (2021) a été mis en place pour limiter les répercussions des effluents sur le milieu récepteur et prévoit une surveillance régulière des concentrations de métaux dans les effluents, ainsi que de leur toxicité et de leurs effets sur l’environnement. Les recherches actuelles sont axées sur l’amélioration du recyclage et de l’utilisation de l’eau dans les opérations minières et sur l’évaluation de l’efficacité du traitement dans le cadre de différents scénarios climatiques qui permettraient d’améliorer la gestion des volumes d’eau, de réduire la consommation d’eau douce, de réduire les éléments préoccupants rejetés dans l’environnement et d’atténuer les risques pour le milieu aquatique. En ce qui concerne la compréhension des répercussions environnementales de l’exploitation minière sur les bassins hydrographiques, il existe encore d’importantes lacunes dans les données. En voici des exemples : comprendre la manière dont les métaux se comportent dans les mélanges, la toxicité associée aux expositions alimentaires et les effets cumulatifs des changements climatiques sur le devenir et les effets des métaux. Il est essentiel de poursuivre la recherche dans ces domaines afin de pouvoir assurer le développement d’une industrie minière des métaux durable au Canada.
Principales lacunes et principaux besoins
Évaluer le recyclage de l’eau dans le secteur minier. Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des traitements dans le cadre de scénarios de changements climatiques, et d’optimiser les meilleures technologies disponibles dans le but de réduire la consommation d’eau et les contaminants rejetés dans l’environnement.
Améliorer la pertinence environnementale des évaluations des risques liés aux métaux dans les régions minières. Il est nécessaire de comprendre le comportement des métaux dans les mélanges, les expositions alimentaires et les effets cumulatifs des changements climatiques sur la qualité de l’eau, afin de pouvoir mener des activités d’extraction de métaux durables dans un climat en mutation.
Coordonner la surveillance environnementale des régions affectées par l’exploitation minière. Une coordination nationale et plurigouvernementale de la collecte et de l’analyse des données de surveillance de la qualité de l’eau dans l’ensemble du Canada est nécessaire pour mieux comprendre les répercussions environnementales de l’exploitation minière dans un contexte de changements climatiques et soutenir la réglementation sur les effluents.
Consommation d’eau souterraine
Messages clés
Au Canada, les problèmes de qualité et de quantité de l’eau dus à la surexploitation des eaux souterraines devraient s’aggraver au cours des prochaines décennies en raison de la densification de la population, de l’accroissement des activités industrielles et agricoles, et des changements climatiques.
L’amélioration des méthodes de collecte de données et de surveillance, ainsi que de la modélisation définit la capacité de comprendre l’hydrodynamique des systèmes hydrogéologiques partout au Canada, d’évaluer l’utilisation durable des aquifères, de quantifier les bilans hydriques et les bilans des eaux souterraines, d’intégrer les changements dans le temps, tels que l’utilisation des terres, les extractions d’eau et les changements climatiques, et d’assurer une détection hâtive des problèmes possibles.
Résumé
Plus de 30 % des Canadiens dépendent directement des eaux souterraines pour leur eau potable. L’eau souterraine est la principale source d’approvisionnement en eau potable pour environ 80 % de la population rurale du Canada. Bien que l’eau souterraine joue un rôle essentiel dans le cycle de l’eau en tant que source d’eau tout au long de l’année pour des écosystèmes tels que les milieux humides (en fournissant ainsi une contribution essentielle pendant les périodes de débit faible) dans la majeure partie du Canada, elle a été peu étudiée par le passé. Ainsi, on en sait peu sur la quantité d’eau souterraine stockée dans les aquifères canadiens, l’alimentation spécifique et le rendement soutenu de ces systèmes, ou encore sur les répercussions sur la qualité de l’eau, y compris sur les écosystèmes connectés. L’augmentation de la population entraîne une urbanisation accrue, une intensification de l’agriculture et l’accroissement des activités industrielles. Combinés aux changements climatiques et à l’adaptation à ces changements climatiques, ces facteurs de stress peuvent avoir des répercussions sur la disponibilité des ressources en eaux souterraines. Bien que le Canada extraie généralement de l’eau souterraine à des niveaux durables, les problèmes locaux se multiplient, et il faut noter que les répercussions sur les eaux souterraines et sur les aquifères, qui peuvent prendre de nombreuses années ou des décennies avant d’être détectées, peuvent être extrêmement difficiles, voire impossibles à restaurer. Des données sont nécessaires pour mieux comprendre l’hydrodynamique des systèmes hydrogéologiques, évaluer l’utilisation durable et détecter rapidement d’éventuels problèmes en matière de quantité ou de qualité. Des efforts importants sont nécessaires pour améliorer les méthodes et les approches qui permettent d’évaluer plus efficacement les ressources en eaux souterraines, notamment la caractérisation de la qualité des aquifères et des eaux souterraines, l’estimation des bilans hydriques, les extractions et les débits durables. Étant donné que les eaux de surface et les eaux souterraines sont intimement liées et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées isolément, des modèles numériques couplés, qui coordonnent les répercussions des changements d’utilisation des terres et les changements climatiques, doivent être élaborés par des équipes multidisciplinaires afin d’éclairer les mesures qui assurent la protection à long terme et l’utilisation durable des ressources en eau. Mieux comprendre les systèmes naturels d’eaux souterraines, ainsi que les répercussions des activités humaines, demeure un domaine de recherche crucial qui permettra de mieux répondre aux divers problèmes sociaux et environnementaux associés aux ressources en eau dans les années à venir.
Principales lacunes et principaux besoins
Combler les lacunes dans les connaissances. La mise en place et l’entretien d’un réseau national de postes de surveillance et l’élargissement de l’acquisition de données, en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, sont nécessaires pour renforcer la capacité de connaissances sur l’hydrodynamique des systèmes hydrogéologiques partout au Canada.
Mener des travaux scientifiques globaux et améliorés sur l’eau. Les travaux scientifiques exhaustifs sur l’eau douce menés par des équipes multidisciplinaires, les modèles globaux coordonnant les interactions entre les eaux souterraines, les eaux de surface, l’atmosphère et les terres, la modélisation numérique des répercussions découlant des changements d’utilisation des terres et des changements climatiques demeurent nécessaires pour assurer la protection à long terme et l’utilisation durable des ressources en eau.
Rendre les données accessibles et utilisables. Des méthodes et des approches améliorées aidant à la collecte et à l’interprétation des données, y compris des normes nationales définies, sont nécessaires pour mieux caractériser les aquifères tout en utilisant moins de ressources et, finalement, pour faire circuler les données relatives au cycle de l’eau dans tous les domaines de l’eau douce (tant les eaux de surface que les eaux souterraines) afin d’alimenter les efforts de modélisation globaux.
Mobiliser les connaissances scientifiques. Il est nécessaire d’améliorer les approches de mobilisation des connaissances sur l’eau douce, y compris la technologie et l’expertise qui tiennent compte des besoins d’un large éventail de publics, comme les décideurs politiques et les membres du public, afin de favoriser le dialogue pour établir un lien entre les préoccupations régionales et le contexte national plus large.
Contaminants et d’autres polluants
Les contaminants et d’autres polluants ont divers effets négatifs sur les écosystèmes d’eau douce, y compris la biodiversité, les habitats et les communautés. Afin de protéger les plans d’eau du Canada pour l’avenir et, à terme, de limiter les effets négatifs sur les écosystèmes d’eau douce, notamment par la mise en œuvre de politiques, de règlements et de mesures, une meilleure compréhension commune des contaminants et des polluants, y compris les mélanges et les effets combinés d’autres facteurs de stress, demeure essentielle. Les anciens contaminants et les contaminants émergents, les nutriments excédentaires, les proliférations d’algues nuisibles, les perturbateurs du système endocrinien, les pesticides, les matières plastiques, les effluents d’eaux usées municipales, les eaux de ruissellement urbaines et les mélanges chimiques présentent un intérêt particulier.
Auteurs et contributeurs
Contaminants émergents et anciens contaminants
Authors: Aijaz Baig1, Anne Gosselin1, et Kwasi Nyarko1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Nutriments excédentaires
Authors: Robert B. Brua1, Alexa Alexander-Trusiak1, Andrew Bramburger1, David Depew1, Jane Elliott1, Chris Parsons1, Jim Roy1, et John Spoelstra1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles
Authors: David Depew1, Arthur Zastepa1, Caren Binding1, and Sophie Crevecoeur1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Perturbateurs du système endocrinien
Author: Joanne Parrott1
1 Environment and Climate Change Canada
Pesticides
Authors: A.C. Alexander Trusiak1, Jennifer Allen2, Serban Danielescu3, Tobias Laengle2, Tim MacDonald4, Miranda Morrison5, Claudia Sheedy2, et Janice Villeneuve4
1 Environnement et Changement climatique Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada / Université du Nouveau-Brunswick
2 Agriculture et Agroalimentaire Canada
3 Environnement et Changement climatique Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada
4 Santé Canada / Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
5 Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada
Matières plastiques*
Editors: Kelly Hodgson1 et Jean-François Bibeault1
1 Environnement et Changement climatique Canada
* Le contenu de ce document se concentre principalement sur les informations relatives à l’eau directement tirées de l’évaluation scientifique de la pollution plastique (octobre 2020), qui résume l’état actuel de la science concernant les impacts potentiels de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que pour guider les recherches futures et éclairer la prise de décision en matière de pollution plastique au Canada.
Effluents d’eaux usées municipales
Author: Christian Gagnon1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Eaux de ruissellement urbaines
Author: Christian Gagnon1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Mélanges chimiques
Author: Mark Hewitt1
1 Environnement et Changement climatique Canada
Contaminants émergents et anciens contaminants
Messages clés
Les anciens contaminants et les contaminants émergents sont de plus en plus préoccupants dans l’environnement, car ils représentent une menace importante pour l’environnement et la santé humaine en raison de leurs effets toxicologiques potentiels et des risques connexes pour les écosystèmes d’eau douce au Canada.
Ces contaminants sont largement présents et répartis dans le milieu aquatique. Parmi ceux-ci, mentionnons les produits pharmaceutiques, les produits de soins personnels, les additifs industriels, les pesticides, les nanomatériaux manufacturés, les produits ignifuges, les agents de surface, les perturbateurs endocriniens, les matières plastiques et les terres rares.
Résumé
L’industrie chimique est l’un des plus grands secteurs industriels au monde, et ce secteur devrait quadrupler d’ici 2060. Au Canada comme dans de nombreux autres pays, des milliers de substances et de produits chimiques sont utilisés dans les processus industriels et la fabrication de biens de consommation, de nouveaux produits chimiques étant mis au point ou importés chaque jour. Les anciens contaminants et les contaminants émergents sont de plus en plus préoccupants dans l’environnement, car ils représentent une menace importante pour l’environnement et la santé humaine en raison de leurs effets toxicologiques potentiels et des risques connexes pour les écosystèmes d’eau douce au Canada. Ces contaminants nouvellement préoccupants sont largement présents et répartis dans le milieu aquatique. Les connaissances scientifiques sur les contaminants émergents n’ont pas encore été pleinement mises à profit pour appuyer l’élaboration de décisions réglementaires fondées sur des données probantes visant à protéger les sources d’eau douce, les écosystèmes et la santé humaine. Il est nécessaire de recenser et de classer par ordre de priorité les contaminants émergents et les anciens contaminants nouvellement préoccupants, et de mettre au point des outils d’analyse, des méthodes et des modèles de prévision décrivant leur devenir, leur transport et leurs transformations dans l’environnement en faisant appel à une approche axée sur le cycle de vie (p. ex. les voies de production, de consommation et d’élimination).
Principaux besoins et lacunes
Renforcer le recensement et le classement par ordre de priorité des contaminants émergents et des anciens contaminants préoccupants. Il est nécessaire d’accorder une attention soutenue au recensement et au classement par ordre de priorité des contaminants émergents et des anciens contaminants nouvellement préoccupants, notamment par la mise au point d’outils d’analyse, de méthodes et de modèles de prévision modernes, afin que le devenir, le transport et les transformations de ces contaminants soient mieux pris en compte dans les évaluations environnementales fondées sur le cycle de vie.
Élaborer une stratégie abordant la question à l’échelle nationale. Il est nécessaire d’élaborer une approche pangouvernementale visant à éclairer l’élaboration d’une stratégie nationale pour les anciens contaminants et les contaminants émergents présents dans l’environnement, qui comprend l’échange des données et la surveillance communautaire, afin de combler de façon systématique, efficace, informative et opportune les nouvelles lacunes en matière de connaissances scientifiques et de recherche.
Nutriments excédentaires
Messages clés
La surabondance de nutriments dans les lacs et les rivières contribue à la dégradation des eaux souterraines et de surface, et constitue un « grave problème » en raison de sa complexité. Dans l’ensemble, il s’agit d’une menace répandue, reconnue à l’échelle nationale, pour les services écosystémiques (p. ex. l’approvisionnement en eau potable, les activités de loisirs, la réduction de la biodiversité) dont dépendent les Canadiens.
Les concentrations de nutriments, comme le phosphore et l’azote, continuent d’augmenter dans les eaux souterraines et de surface. Alors que certaines concentrations atteignent ou dépassent les recommandations existantes, certaines régions du Canada ne disposent pas de valeurs recommandées auxquelles comparer les concentrations de nutriments et n’ont pas pris de mesures pour lutter contre les nutriments excédentaires.
Résumé
Les nutriments, principalement l’azote et le phosphore, sont essentiels à la croissance des plantes en eau douce et influent sur la productivité de la plupart des écosystèmes. L’urbanisation, l’agriculture et les changements climatiques entraînent un excédent de nutriments dans les eaux souterraines et de surface, qui dépasse les limites de la durabilité de nombreux écosystèmes. Cet excédent de nutriments provoque l’eutrophisation, une menace répandue et reconnue à l’échelle nationale pour la qualité de l’eau douce au Canada. La contamination des eaux souterraines, utilisées comme source d’eau potable par de nombreux Canadiens, constitue également une préoccupation. La dégradation des eaux douces attribuable aux nutriments excédentaires limite les services que celles-ci procurent aux Canadiens. Parmi les exemples de cette dégradation, citons la transformation de communautés d’eau douce diversifiées en communautés dominées par des organismes tolérants à la pollution, la prolifération d’algues toxiques et nuisibles pouvant contaminer les réserves d’eau potable, la limitation des activités récréatives, la mortalité des poissons et l’augmentation subséquente du fardeau économique pour les Canadiens, notamment en raison des coûts d’infrastructure et de traitement des eaux que subissent souvent les communautés rurales. Il est urgent de mieux comprendre les effets des nutriments rejetés par certaines sources, comme les étangs d’épuration, et les répercussions des réserves de nutriments hérités, d’analyser l’absorption et la rétention des nutriments dans les eaux douces et d’effectuer des recherches sur les ratios de nutriments. Il est également nécessaire de mettre en œuvre des activités essentielles telles que la surveillance des eaux souterraines et la mise au point d’indicateurs d’alerte précoce de la santé écologique des eaux douces. Étant donné que les sources de nutriments comprennent notamment les eaux usées municipales, les fosses septiques, les activités agricoles, les pratiques industrielles, les dépôts atmosphériques et les bassins d’eaux pluviales, il est nécessaire de continuellement réaliser des initiatives multisectorielles importantes et efficaces, en tirant parti des efforts existants tels que les laboratoires vivants ou les activités scientifiques citoyennes à l’échelle des bassins versants, et de coordonner ces efforts scientifiques pour lutter contre les menaces que représentent les nutriments pour les écosystèmes d’eau douce au Canada.
Principaux besoins et lacunes
Recherche sur l’impact des rejets de nutriments sur la santé des écosystèmes aquatiques. Il est nécessaire de mieux comprendre les rejets de nutriments, comme ceux provenant des étangs de traitement des eaux usées, pour surveiller leurs effets sur la santé des écosystèmes aquatiques et de mesurer les résultats des mesures d’atténuation, y compris la modernisation des installations de traitement des eaux usées, afin d’éclairer à terme les prévisions et les pratiques de gestion.
Mettre au point des indicateurs modernes d’alerte précoce des concentrations de nutriments. Il est nécessaire de déterminer les indicateurs d’alerte précoce, en tirant parti des avancées modernes telles que la génomique et la métabolomique, pour mieux évaluer et diagnostiquer les effets des nutriments sur la santé des écosystèmes aquatiques.
Mener des recherches sur les ratios de nutriments et sur leurs liens avec la santé des écosystèmes aquatiques. Une compréhension exhaustive des effets des déséquilibres entre l’azote et le phosphore (ratios de nutriments) sur les eaux douces et les services écosystémiques qu’elles procurent est nécessaire pour déterminer la productivité et les limites des écosystèmes d’eau douce et favoriser la mise au point d’indicateurs d’alerte précoce visant à atténuer les effets néfastes.
Proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles
Messages clés
Les proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles sont reconnues comme une menace importante pour la santé des humains et des écosystèmes. Bien que les apports de nutriments excédentaires augmentent le risque de proliférations, une interaction complexe de différents facteurs (p. ex. le climat, l’hydrodynamique, la morphométrie des lacs et des rivières) détermine où, quand et comment les proliférations se manifestent et les effets qu’elles auront.
L’accumulation de la biomasse phytoplanctonique qui constitue les proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles peut perturber les flux d’énergie et de nutriments dans le réseau trophique, modifier les propriétés chimiques de l’eau et détériorer les utilisations des cours d’eau. La production de toxines par ces proliférations peut rendre l’eau impropre à la consommation.
Pour atténuer et gérer efficacement les proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles, une compréhension fondée sur l’emplacement de ces facteurs, de la structure et de la fonction de la communauté phytoplanctonique ainsi que des résultats souhaités est nécessaire.
Résumé
Les proliférations de cyanobactéries et d’algues nuisibles constituent des problèmes environnementaux et de santé publique, tant au Canada que dans le monde entier. Si l’eutrophisation est sans doute le déclencheur le plus connu de ces proliférations dans les systèmes d’eau douce, d’autres effets anthropiques peuvent favoriser l’apparition de proliférations. En outre, les espèces qui composent les proliférations de cyanobactéries et d’algues ont développé de nombreuses relations mutualistes avec d’autres microbes et le phytoplancton, lesquelles peuvent être importantes pour leur survie et leur domination. Les proliférations dépendent des effets synergiques des apports en nutriments, des facteurs physiques et des interactions biotiques. Les efforts d’atténuation reposent en grande partie sur la réduction des apports en nutriments plutôt que sur des manipulations biologiques ou physiques. À l’échelle nationale, la rareté des données et les approches fragmentées en matière de surveillance entravent la capacité à détecter rapidement l’apparition de proliférations et à communiquer efficacement les risques. La mise en place de réseaux d’observation de la Terre et de réseaux de capteurs constitue une voie prometteuse pour assurer la détection rapide et à distance des proliférations. En outre, les progrès en matière de modélisation des écosystèmes, en particulier dans le cadre d’une approche prédictive ou prévisionniste, pourraient permettre de mieux comprendre les déclencheurs des proliférations et le rôle que joue la production de toxines cyanobactériennes. Des efforts supplémentaires visant à caractériser ces toxines et leur traitement pourraient permettre de prendre des mesures d’atténuation plus efficaces, notamment au niveau des prises d’eau, où les proliférations ne peuvent pas être maîtrisées rapidement par les méthodes classiques. Le recours à l’observation de la Terre depuis l’espace évolue rapidement, et l’expansion d’outils comme AttentionLacsOT, en plus des nouvelles observations spatiales hyperspectrales, sera nécessaire pour lutter contre les proliférations d’algues nuisibles au Canada.
Principaux besoins et lacunes
Améliorer la modélisation prédictive de l’ampleur, de l’intensité, de la durée et de l’emplacement des proliférations. Il est nécessaire de pouvoir prédire les systèmes à risque de proliférations à l’aide de données fondées sur des processus (mécanistes) afin de mieux comprendre les effets des facteurs environnementaux sur les événements futurs et leurs trajectoires et d’évaluer les stratégies d’atténuation.
Détecter les proliférations d’algues nuisibles et y répondre efficacement. Il est nécessaire d’instaurer un cadre national à l’appui d’une réponse coordonnée aux proliférations d’algues nuisibles qui comprend la détection rapide, la surveillance spatiotemporelle (y compris les technologies modernes comme les observations de la Terre), l’identification et le signalement pour garantir que les activités scientifiques exhaustives et inclusives se traduisent par des réponses efficaces et éclairées, notamment en ce qui a trait à la gestion des risques associés à l’approvisionnement en eau potable et aux activités économiques et récréatives durables.
Caractériser et traiter les toxines cyanobactériennes. Il est nécessaire d’avoir une meilleure compréhension des facteurs de production de biomasse, de toxines et de métabolites bioactifs propres aux plans d’eau ainsi que des espèces ou souches de phytoplancton dominantes pour étudier le lien entre les cyanobactéries benthiques et la santé humaine afin d’éclairer les recommandations canadiennes sur la qualité de l’eau.
Perturbateurs du système endocrinien
Messages clés
La présence de perturbateurs du système endocrinien (qui perturbent la croissance et la reproduction des poissons et des espèces animales) dans les eaux canadiennes est préoccupante.
Ces produits chimiques sont difficiles à détecter, car ils sont présents dans de nombreux produits différents, et difficiles à étudier, car leurs effets peuvent prendre du temps à apparaître.
Une meilleure compréhension des liens entre les effets des perturbateurs du système endocrinien sur les organismes et les écosystèmes nous aidera à protéger les milieux canadiens.
Résumé
Les perturbateurs du système endocrinien (PSE) ont divers mécanismes d’action et proviennent notamment de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et des produits de consommation. Ces produits chimiques se retrouvent souvent dans les eaux canadiennes, où ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des organismes à de faibles concentrations. Les PSE sont présents dans de nombreux milieux canadiens, notamment dans les rivières et les lacs qui reçoivent des effluents d’usines de pâte à papier et des effluents d’eaux usées municipales, ainsi que dans les zones historiquement contaminées des Grands Lacs. La sensibilité des espèces et le degré d’exposition peuvent influer sur la puissance des PSE, et il existe des « fenêtres d’exposition » critiques où les changements subis par les organismes peuvent être irréversibles. Il est nécessaire de disposer de méthodes d’essai validées pour évaluer les effets multiples des PSE. Nous devons mieux comprendre les effets complexes des mélanges chimiques sur le système endocrinien et étudier le lien entre ces effets et les changements au sein des populations et des communautés écologiques. À l’avenir, une coordination nationale en matière de détection, de recherche et de réglementation relatives aux PSE sera nécessaire pour que nous puissions protéger les milieux aquatiques canadiens contre les PSE.
Principaux besoins et lacunes
Améliorer la méthodologie d’évaluation des perturbateurs du système endocrinien (PSE). Des méthodes d’essai validées permettant de détecter et d’étudier les PSE sont nécessaires afin de comprendre la façon dont ils modifient les populations et les communautés écologiques et de mieux les réglementer.
Poursuivre les efforts visant à comprendre les réactions des écosystèmes. Il est nécessaire d’acquérir des connaissances sur les écosystèmes canadiens, la biologie fondamentale de la reproduction du biote aquatique et les interactions entre espèces dans les milieux naturels pour mieux comprendre les effets globaux des PSE et d’autres produits chimiques.
Pesticides
Messages clés
Les pesticides peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et de surface par l’entremise d’une pollution diffuse ou ponctuelle et être toxiques pour les espèces non ciblées comme les humains et d’autres animaux.
L’utilisation de pesticides doit être étudiée de manière plus globale afin de mieux tenir compte de la présence de multiples facteurs de stress, comme les nutriments pénétrant dans les milieux d’eau douce, en particulier lors de phénomènes météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques.
Résumé
L’utilisation mondiale de pesticides a entraîné une dégradation généralisée de l’environnement, une contamination persistante des eaux souterraines et de surface, la bioaccumulation de ces contaminants dans les réseaux trophiques et des effets non désirés sur des espèces non ciblées (p. ex. abeilles, insectes aquatiques et poissons). Des études récentes se penchent toujours sur la toxicité et le devenir des pesticides individuels et des mélanges de pesticides dans l’environnement, les différentes utilisations des pesticides variant selon le secteur économique, la cible prévue, les pratiques régionales et, bien sûr, le climat. Ainsi, les efforts déployés dans ce domaine doivent non seulement être appuyés par une coordination nationale, mais aussi par des approches régionales pertinentes qui reflètent les orientations provinciales et territoriales, et reconnaître que les pesticides ont une raison d’être et sont largement utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles. Il est nécessaire d’acquérir une compréhension plus globale des pesticides, qui tient compte des différents besoins sectoriels et des mélanges pertinents pour l’agriculture, les transports, la sylviculture et l’industrie lourde. En outre, la prise en compte des risques associés à d’autres gradients environnementaux, comme les changements climatiques, exigera l’application d’une méthode plus précise permettant de comprendre que les substances chimiques sont présentes dans l’environnement sous forme de mélanges et non de substances distinctes, et que ces mélanges peuvent interagir entre eux. À l’avenir, un soutien interministériel et des travaux de recherche sur les effets des pesticides sur l’environnement continueront d’être nécessaires, tandis que de nouveaux investissements dans les plateformes de données, l’infrastructure et le personnel seront essentiels pour mieux coordonner la surveillance et les programmes relatifs aux pesticides dans l’ensemble du Canada.
Principaux besoins et lacunes
Recherche sur les impacts à long terme des pesticides sur les écosystèmes aquatiques. Des travaux de recherche sur l’évaluation des effets des pesticides et de leurs interactions avec de multiples facteurs de stress (p. ex. l’eutrophisation) sont nécessaires pour évaluer globalement leurs effets négatifs sur les populations d’espèces sauvages.
Améliorer l’évaluation des effets des mélanges de pesticides. Des travaux de recherche sur les effets toxiques des mélanges de pesticides et d’autres substances sur les milieux aquatiques sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière de réglementation de multiples substances, notamment pour aider à évaluer la contribution relative de chaque composé à l’effet toxique global des mélanges.
Améliorer la coordination des activités de surveillance. Des approches nationales coordonnées et cohérentes en matière de surveillance (p. ex. l’utilisation d’un échantillonneur automatique sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) et des données accessibles au public sont nécessaires pour améliorer la compréhension des effets des pesticides sur l’environnement.
Matières plastiques
Messages clés
Les matières plastiques rejetées dans le milieu peuvent être transformées en particules et transportées vers les plans d’eau de surface par l’érosion éolienne et hydrique. Les microplastiques qui en résultent peuvent ensuite s’accumuler dans les sédiments et les sols et, à terme, pénétrer dans la chaîne alimentaire par ingestion.
La présence de pollution plastique dans les plans d’eau constitue une menace pour la fonction écosystémique, la biodiversité et l’intégrité des habitats, tant dans les eaux douces que dans les eaux marines. Souvent, les espèces sauvages sont asphyxiées par les matières plastiques ou ingèrent ces dernières, ce qui peut leur être néfaste. De plus, les déchets marins peuvent transporter des espèces exotiques et perturber la structure et la fonction d’autres écosystèmes bien établis.
Les matières plastiques peuvent contenir des additifs chimiques et absorber les polluants organiques persistants présents dans l’environnement. Ces contaminants peuvent donc également être transférés aux organismes aquatiques, où ils s’accumulent et peuvent causer des dommages.
Résumé
Depuis les années 1950, le volume de matières plastiques a augmenté, et ces dernières sont devenues omniprésentes dans tous les principaux compartiments de l’environnement. Plus récemment, des microplastiques ont été signalés dans les zones benthiques des eaux canadiennes, dans des lacs importants comme les lacs Winnipeg, Supérieur et Érié, et de grandes quantités de microplastiques ont été trouvées en Arctique dans des sédiments abyssaux, des eaux (souterraines) marines et des carottes de glace. Des déchets plastiques mal gérés se retrouvent désormais dans les zones littorales, les eaux de surface, les sédiments, le sol, les eaux souterraines, l’air intérieur et extérieur, l’eau potable et les aliments. En outre, il est probable que la pollution plastique augmente à l’avenir. Au Canada, les déchets plastiques comprennent les sacs et les bouteilles à usage unique, les microplastiques, comme les fragments de plastiques à usage unique, les microbilles et les fibres, ainsi que les petites particules nanoplastiques. Comme les matières plastiques se dégradent très lentement, elles restent dans l’environnement pendant une période extrêmement longue. Dans les plans d’eau, les matières plastiques mettent en péril les fonctions écosystémiques, la biodiversité et l’intégrité des habitats. Les espèces sauvages sont souvent asphyxiées par les matières plastiques ou ingèrent ces dernières, ce qui peut leur être néfaste. Bien qu’il existe actuellement un certain nombre d’initiatives de recherche et de développement visant la réduction des déchets plastiques, les travaux sont en grande partie effectués de manière isolée et bénéficieraient d’une coordination accrue, d’une collaboration, d’une mobilisation des connaissances et d’un renforcement des capacités afin de mieux utiliser l’expertise et les ressources existantes. Il est nécessaire de mettre au point des méthodes normalisées pour l’échantillonnage, la quantification, la caractérisation et l’évaluation des effets des macroplastiques et des microplastiques, et de déployer des efforts de surveillance continus pour tenir compte des compartiments environnementaux mal caractérisés.
Principaux besoins et lacunes
Accroître les activités de surveillance et de suivi systématiques et normalisées. Il est nécessaire d’élaborer des méthodes normalisées d’échantillonnage, de quantification et de caractérisation des matières plastiques (y compris les microplastiques et les nanoplastiques) dans les principales rivières et les principaux lacs du pays pour recueillir des données sur leur présence, leur abondance et leurs tendances, afin d’appuyer l’évaluation continue des risques relatifs et des régions préoccupantes dans l’ensemble du Canada.
Améliorer la caractérisation de leur présence et de leurs effets. Des travaux de recherche sur les sources et la transformation des matières plastiques, sur l’exposition à celles-ci et sur leurs effets sur la santé des écosystèmes aquatiques sont nécessaires pour mieux comprendre le devenir et les effets des matières plastiques dans l’environnement.
Améliorer l’évaluation de leur accumulation dans le biote aquatique et de leur transfert par celui-ci. Des études portant sur la bioamplification, la bioaccumulation et la bioconcentration des matières plastiques dans les écosystèmes aquatiques sont nécessaires pour mieux comprendre les effets des matières plastiques sur le réseau trophique et leurs effets cumulatifs sur les organismes aquatiques.
Effluents d’eaux usées municipales
Messages clés
Les eaux usées municipales constituent la plus importante source ponctuelle d’effluents dans les écosystèmes d’eau douce au Canada et contiennent des mélanges de contaminants qui peuvent produire des effets cumulatifs.
Les installations classiques de traitement des eaux usées ne sont pas conçues pour éliminer les contaminants à l’état de traces, les métaux, les anciens contaminants, les toxines algales ni les nouvelles substances préoccupantes comme les produits ignifuges, les agents de surface, les antioxydants et les substances pharmaceutiques. Ces produits sont mesurés dans les effluents d’eaux usées et dans les eaux réceptrices en aval.
En raison de la hausse des charges de contaminants apportées par ces rejets, les effets sur l’environnement et la santé attribuables à un traitement insuffisant des eaux usées perdurent.
Résumé
Les eaux usées municipales sont des mélanges complexes qui peuvent avoir divers effets sur les milieux aquatiques. Le rejet direct des eaux usées municipales, constituées de déchets liquides et d’eaux usées, constitue la plus grande source de ces effluents dans les écosystèmes d’eau douce au Canada. Malgré les améliorations apportées aux procédés de traitement, certains écosystèmes d’eau douce continuent d’être perturbés par des effluents qui ont des effets cumulatifs et synergiques sur les communautés aquatiques. Les installations de traitement des eaux usées ne sont pas conçues pour éliminer les contaminants à l’état de traces, comme les métaux, les anciens contaminants et les nouvelles substances préoccupantes, y compris les additifs chimiques et les produits pharmaceutiques. Ces contaminants demeurent donc dans les effluents d’eaux usées et se retrouvent dans les milieux récepteurs. La réglementation fédérale précise les limites maximales de certains paramètres dans les effluents afin de protéger les écosystèmes d’eau douce. La mise au point et l’application de technologies destinées aux installations de traitement sont axées sur la capacité des systèmes et l’amélioration de la qualité des effluents, ce qui peut contribuer à modifier la matrice chimique et sa série d’effets potentiels. Il est nécessaire de mieux comprendre les effets des mélanges et les effets cumulatifs, comme la génotoxicité et la perturbation endocrinienne, de multiples rejets d’effluents. À l’avenir, une forte coordination nationale en matière de recherche sur les mélanges de substances sera nécessaire, de même que l’élaboration d’outils et d’approches permettant de faire face aux risques posés par les contaminants et leurs produits de transformation rejetés par les installations de traitement des eaux usées municipales.
Principaux besoins et lacunes
Améliorer la compréhension des effets écotoxicologiques de nouvelles substances toxiques. Des travaux de recherche visant à évaluer le devenir et les effets de nouvelles substances toxiques et de leurs produits de transformation générés par des processus naturels dans les milieux récepteurs et le traitement des eaux usées sont nécessaires pour éclairer et appuyer de nouvelles pratiques de gestion efficaces pour ces substances émergentes.
Améliorer l’évaluation des risques liés à l’exposition chronique aux effluents municipaux. Il est nécessaire d’axer davantage la recherche sur les effets chroniques (comme la génotoxicité et la perturbation endocrinienne) afin de mieux évaluer les contaminants rejetés par le traitement des eaux usées et les processus naturels de transformation.
Évaluer les effets des mélanges chimiques et les effets cumulatifs des facteurs de stress. Il est nécessaire de mener des recherches pour évaluer de manière exhaustive la combinaison de contaminants et de facteurs de stress (comme les agents pathogènes et les virus) provenant de multiples rejets d’effluents afin de prévenir les problèmes écologiques et de santé humaine en adoptant une approche plus globale des écosystèmes aquatiques.
Eaux de ruissellement urbaines
Messages clés
Des effets cumulatifs sont générés à partir des mélanges associés à l’écoulement de surface en milieu urbain, incluant les eaux de surverse, à la re-suspension des sédiments provenant des eaux usées, et aux eaux usées non traitées.
Il demeure encore plusieurs inconnues relatives aux quantités et à la forme que prennent les contaminants qui atteignent les eaux de surface, et aussi à la manière dont ils contribuent aux problèmes écologiques et de santé des écosystèmes aquatiques.
Les gains environnementaux attribuables au traitement des eaux usées et des autres mesures de contrôle pourraient être atténués par l’augmentation de l’écoulement de surface et des rejets d’eau usées non traités.
Résumé
La capacité des installations de traitement des eaux usées est limitée dans les municipalités canadiennes, ce qui a entraîné une augmentation des rejets d’eaux non traitées dans l’environnement. Ces eaux usées urbaines non traitées – eaux de ruissellement urbaines – sont constituées de mélanges de contaminants qui peuvent générer des effets toxiques et cumulatifs néfastes. Les eaux de ruissellement urbaines résultant des rejets d’eaux d’égout brutes, d’eaux pluviales et de sédiments d’égout remis en suspension constituent un défi croissant dans le contexte de l’accroissement démographique et de l’urbanisation en hausse. L’accélération des changements climatiques entraînera une augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations, ce qui aggravera les problèmes liés à la capacité de traitement des eaux usées. Les règlements existants pris en vertu de la Loi sur les pêches visent à protéger les poissons en mettant l’accent sur les principaux paramètres toxiques, comme l’ammoniac. Le rejet d’eaux usées non traitées fait ressortir les régions où de nouvelles technologies pourraient être conçues pour mieux gérer les effets des eaux de ruissellement urbaines. Il est nécessaire d’élaborer des approches écotoxicologiques, notamment des essais sur la chronicité pour les expositions à long terme aux eaux usées non traitées et les effets non létaux. À l’avenir, des efforts coordonnés seront nécessaires pour évaluer pleinement la composition et les effets environnementaux des mélanges de contaminants rejetés par les eaux usées non traitées ainsi que les conditions d’exposition, comme l’intensité, la période et la durée des rejets.
Principaux besoins et lacunes
Améliorer la compréhension des effets des eaux usées non traitées. Des travaux de recherche sur le devenir et les effets des rejets de contaminants causés par des précipitations plus fréquentes et plus intenses sont nécessaires pour évaluer les conséquences environnementales d’une capacité de traitement des eaux usées insuffisante dans un climat en évolution.
Améliorer l’évaluation des effets des mélanges et des effets cumulatifs. Des travaux de recherche sur les interactions et les effets combinés de divers contaminants et facteurs de stress sont nécessaires pour évaluer pleinement les effets sur l’environnement des mélanges de contaminants rejetés par de multiples effluents dans un même bassin versant.
Améliorer l’intégration de la recherche fondée sur les effets et de la modélisation hydrodynamique. Il est nécessaire d’effectuer des recherches sur les facteurs environnementaux régissant la variabilité de la qualité et de la quantité des eaux de ruissellement urbaines afin de mieux gérer les effets de ce phénomène.
Mélanges chimiques
Messages clés
Toutes les expositions aux produits chimiques présents dans l’environnement dans les écosystèmes d’eau douce concernent des mélanges contenant des combinaisons de polluants existants, de contaminants nouvellement préoccupants et de substances inconnues.
Des scientifiques ont mis au point des outils et des méthodes permettant de gérer les risques posés par les mélanges et de déterminer des solutions de gestion. Il reste des défis à relever en ce qui concerne la mise en œuvre globale de ces outils au sein des cadres réglementaires et politiques existants.
Il faut centraliser et coordonner les efforts à l’échelle nationale afin de transcender les cloisonnements réglementaires et politiques et de permettre au Canada de détecter, de classer par ordre de priorité et de contrer rapidement les menaces que présentent les mélanges réels pour la santé des écosystèmes aquatiques.
Résumé
Les mélanges réels sont des combinaisons de polluants déjà connus, de contaminants nouvellement préoccupants et d’un grand nombre de substances inconnues. Les mélanges exercent des effets réels sur les écosystèmes d’eau douce au Canada et dans le monde entier. Les connaissances scientifiques sur les façons de définir, d’identifier et d’étudier les mélanges chimiques préoccupants pour les systèmes d’eau douce ont beaucoup évolué dans les dix dernières années. Des méthodes fondées sur les effets visant à détecter les mélanges préoccupants ont été inventées au Canada, ce qui a permis de délaisser graduellement les évaluations de substances simples. Les organismes de réglementation du monde entier, y compris ceux du Canada, doivent reconnaître la nécessité de se pencher sur ces questions, comme les expositions et les effets cumulatifs. Les effets combinés de plusieurs sources et produits chimiques n’ont pas été évalués de manière régulière ou adéquate, d’où la nécessité de mieux comprendre les aspects chimiques, toxicologiques et écologiques des mélanges chimiques présents dans l’environnement. À l’avenir, il faudra centraliser et coordonner à l’échelle nationale les efforts déployés pour évaluer les mélanges afin de transcender les cloisonnements réglementaires et politiques et de permettre au Canada de détecter, de classer par ordre de priorité et de contrer rapidement les menaces actuelles et futures que présentent les mélanges existants et les produits chimiques nouvellement préoccupants pour la santé des écosystèmes aquatiques.
Principaux besoins et lacunes
Reconnaître la nécessité de prendre en compte les expositions cumulatives aux mélanges chimiques et les effets cumulatifs de ceux-ci. Il est nécessaire de mieux comprendre les mélanges chimiques présents dans l’environnement et la façon dont ils réagissent et influent sur l’environnement afin de tenir compte des effets combinés de plusieurs sources et produits chimiques dans les évaluations des risques.
Créer des incitatifs favorisant les approches innovantes. De nouvelles approches de gestion et d’évaluation contribuant à une économie circulaire sont nécessaires pour gérer les mélanges chimiques à l’échelle nationale et protéger les écosystèmes d’eau douce contre diverses substances nocives.
Acquérir du matériel permettant de détecter et de caractériser les mélanges chimiques. De façon générale et en appui aux priorités du gouvernement, il est nécessaire de renforcer les capacités et l’expertise des laboratoires pour lutter contre les menaces actuelles et futures que présentent les mélanges chimiques pour la santé des écosystèmes aquatiques.
Défis transversaux
Bien qu’il existe des liens entre les facteurs de stress et les problèmes décrits dans les sections précédentes, de nombreux thèmes globaux liés à l’eau douce transcendent souvent les objectifs d’un ministère, d’une administration ou d’un secteur et peuvent permettre d’établir des liens entre les facteurs de stress liés à l’eau douce, ce qui nécessite des relations de collaboration solides et durables pour guider et réunir les experts et, en fin de compte, mieux orienter les mesures d’intendance de l’eau douce. Au nombre de ces sujets, mentionnons les facteurs de stress multiples et les effets cumulatifs, la biodiversité aquatique, les répercussions des facteurs de stress sur les services écosystémiques et la gestion des flux environnementaux.
Auteurs et contributeurs
Facteurs de stress multiples et effets cumulatifs
Auteurs: Alexa Alexander-Trusiak1, Serban Danielescu2, Lee Grapentine3, Eric Luiker1, Catherine McKenna1, Wendy Monk1, et Diogo Pinho da Costa3
1 Environnement et Changement climatique Canada / Université du Nouveau-Brunswick
2 Environnement et Changement climatique Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada
3 Environnement et Changement climatique Canada
Maintenir la biodiversité aquatique
Auteurs: Jordan Musetta-Lambert1, Thomas Reid1, Robert B. Brua1, Donald Baird2, et Lee Grapentine1
1 Environnement et Changement climatique Canada
2 Environnement et Changement climatique Canada / Université du Nouveau-Brunswick
Effets des facteurs de stress sur les services écosystémiques
Auteurs: Donald Baird1, Natalie Rideout2, Matilda Kattilakoski1, Robert B. Brua3, Jordan Musetta-Lambert3, et Thomas Reid3
1 Environnement et Changement climatique Canada, Université du Nouveau-Brunswick
2 Institut des rivières canadiennes, Université du Nouveau-Brunswick
3 Environnement et Changement climatique Canada
Gestion des débits environnementaux
Auteurs: Daniel L. Peters1 et Wendy Monk2
1 Environnement et Changement climatique Canada, Université du Victoria
2 Environnement et Changement climatique Canada, Université du Nouveau-Brunswick
Facteurs de stress multiples et effets cumulatifs
Messages clés
Au Canada, il existe très peu de systèmes d’eau douce qui n’ont pas été influencés par un ou plusieurs facteurs de stress qui peuvent, individuellement et ensemble, avoir une incidence sur les écosystèmes d’eau douce.
Les approches actuelles ne sont pas suffisantes pour gérer les risques liés aux multiples facteurs de stress, les effets cumulatifs supplémentaires des facteurs de stress individuels ou l’évolution des gradients environnementaux dans les écosystèmes, ce qui nécessiterait une importante recherche interdisciplinaire élaborée conjointement pour gérer avec succès les risques liés à ces effets.
Résumé
Les facteurs de stress sont rarement présents dans l’environnement sous forme de substances isolées. Il s’agit souvent d’un ensemble de facteurs de stress et les composants de ces ensembles peuvent avoir une incidence individuelle et collective sur les écosystèmes d’eau douce. Les effets supplémentaires découlant de multiples facteurs de stress peuvent également être « cumulatifs », de sorte que ces effets peuvent être importants, même si les effets de chaque substance, lorsqu’ils sont évalués séparément, sont négligeables. Les répercussions ne se limitent pas nécessairement aux produits chimiques : les espèces envahissantes, les parasites, les prédateurs et d’autres membres interdépendants des réseaux trophiques peuvent contribuer aux effets cumulatifs dans les écosystèmes. De plus, bien qu’on estime que 60 % des réserves d’eau douce du Canada s’écoulent vers le nord, la qualité de l’eau dans les vastes écosystèmes nordiques du Canada est en majeure partie inconnue et rarement étudiée. Compte tenu des coûts et des contraintes logistiques liés au travail dans le Nord canadien, l’évaluation de la qualité de l’eau douce, y compris les multiples facteurs de stress et les effets cumulatifs, n’est possible qu’en partenariat avec les communautés locales des Inuits, des Métis et des Premières Nations. Des partenariats communautaires significatifs peuvent également faciliter l’élargissement de la portée du travail au-delà des cloisons érigées entre les domaines de spécialité ou des programmes et ainsi faire la synthèse des effets cumulatifs des gradients environnementaux tels que les changements climatiques. À plus long terme, les écosystèmes d’eau douce du Canada devront faire l’objet d’une recherche globale, interdisciplinaire et élaborée conjointement sur les multiples facteurs de stress et, par extension, sur les effets cumulatifs, afin de protéger cette ressource des plus précieuses pour les générations futures. Une solide recherche interdisciplinaire et élaborée conjointement en partenariat avec les communautés accélérera considérablement l’obtention de résultats significatifs dans ce domaine et sera ultimement nécessaire pour gérer efficacement les risques à l’avenir.
Principaux besoins et lacunes
Donner la priorité à la recherche scientifique sur les processus liés à de multiples facteurs de stress dans les eaux de surface et souterraines. Des travaux scientifiques interdisciplinaires, comprenant des réseaux de surveillance ciblés et l’élaboration de modèles mécanistes nouveaux ou améliorés et d’outils applicables permettant de lier les répercussions de multiples facteurs de stress sur les eaux de surface et souterraines, sont nécessaires pour mieux connaître la diversité locale en ce qui concerne les processus cumulatifs (p. ex., les changements climatiques, la géologie sous-jacente et le dégel du pergélisol) et les seuils d’effet.
Collaborer sur les effets toxiques des mélanges de substances. Une meilleure compréhension des effets toxiques des mélanges de substances sur les différents composants du réseau trophique est nécessaire pour surmonter les difficultés liées à la rareté des données de surveillance dans certaines régions, aux seuils de détection élevés pour le dosage de certains polluants et aux multiples modes d’action.
Mettre davantage l’accent sur la qualité de l’eau dans le Nord. La recherche, la modélisation, la surveillance et la production de rapports sur la qualité de l’eau dans les vastes régions nordiques du Canada sont nécessaires et doivent être inclusives, car environ 60 % de l’approvisionnement en eau douce du Canada coule dans cette région qui abrite également de nombreuses communautés autochtones.
Concevoir des méthodes d’évaluation qui prennent en compte les effets cumulatifs. La conception de méthodes d’évaluation des effets cumulatifs à l’échelle des bassins hydrographiques qui mettent l’accent sur la gestion coordonnée des bassins hydrographiques, y compris le soutien scientifique aux étapes de la conception, est nécessaire pour prendre en compte efficacement les scénarios d’effets cumulatifs multidimensionnels tout en continuant à traiter les facteurs de stress prioritaires dans un contexte environnemental.
Maintenir la biodiversité aquatique
Messages clés
La compréhension et le maintien de la biodiversité sont essentiels à la résilience des écosystèmes et aux services écosystémiques durables fournis aux Canadiens.
Des modifications complexes dictées par le climat (p. ex., les régimes thermiques et hydrologiques et les régimes de précipitations), l’eutrophisation, la brunification, les changements à l’échelle du paysage et à la couverture terrestre, la perte d’habitat, la diminution de la couverture de glace et le dégel du pergélisol modifient de manière différenciée les écosystèmes aquatiques locaux et régionaux, ce qui a une incidence sur la biodiversité à l’échelle de la génétique, des espèces et des communautés.
La recherche coordonnée et collaborative sur le changement de la biodiversité nécessite des points de vue sur les paramètres de la diversité fonctionnelle et structurelle afin de favoriser la résilience climatique des écosystèmes d’eau douce.
Résumé
Il demeure essentiel de mesurer et de protéger la biodiversité des écosystèmes aquatiques au Canada pour favoriser une gestion avisée, maintenir les services écosystémiques essentiels fournis par les eaux douces à la population canadienne et améliorer la résilience aux effets actuels des changements climatiques mondiaux. Cependant, on prévoit que des changements climatiques rapides dans toutes les régions du Canada modifieront considérablement la biodiversité des écosystèmes d’eau douce canadiens par les changements aux régimes thermiques et hydrologiques et aux régimes de précipitations, l’eutrophisation, la brunification, les changements à l’échelle du paysage et à la couverture terrestre, la perte d’habitat, la diminution de la couverture de glace et le dégel du pergélisol. Il est nécessaire de disposer de données d’observation cohérentes et comparables sur les biotes à l’échelle nationale pour évaluer les effets du réchauffement climatique rapide sur la biodiversité ainsi que les liens avec le fonctionnement des écosystèmes. Il est essentiel de connaître les impacts des changements climatiques sur la biodiversité aux niveaux trophiques inférieurs et sur le fonctionnement des réseaux trophiques, comprenant les microorganismes, étant donné leurs liens importants avec la santé et la durabilité des écosystèmes, les émissions de gaz à effet de serre des systèmes aquatiques naturels et la santé humaine. À plus long terme, il faudra une coordination nationale pour la collecte uniforme de données sur les biotes, en particulier dans les régions les plus exposées aux changements climatiques, ainsi que des outils et des méthodes, validés à l’échelle nationale pour faciliter l’évaluation de la biodiversité des eaux douces et pouvant être intégrés aux programmes nationaux actuels (p. ex., le Cadre national de la qualité des eaux, le Réseau canadien de biosurveillance aquatique et Sequencing the Rivers for Environmental Assessment and Monitoring). Pour conclure, il est nécessaire de mieux comprendre les points de vue des Autochtones sur les changements à la biodiversité en fonction du contexte historique et de répondre aux préoccupations actuelles.
Principaux besoins et lacunes
Surveiller de manière uniforme la biodiversité à l’échelle des espèces dans les régions vulnérables. Il est nécessaire de disposer de données nationales uniformes, normalisées et comparables sur les genres et les espèces d’organismes présents dans les régions les plus vulnérables (p. ex., les paysages soumis au dégel du pergélisol), afin d’éviter la perte possible de services fournis par les écosystèmes d’eau douce en réduisant les difficultés associées aux objectifs de conservation des espèces fondés sur des données probantes et en élaborant des mesures d’adaptation et d’atténuation.
Améliorer la compréhension des relations entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Des travaux scientifiques visant à évaluer les répercussions du réchauffement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes et à déterminer de quelle façon il influe sur la biodiversité sont nécessaires pour améliorer la modélisation, la planification et les mesures d’adaptation relatives aux changements environnementaux.
Intégrer les connaissances scientifiques et autochtones à la recherche sur la biodiversité. Une compréhension plus approfondie et respectueuse des effets des changements à la biodiversité sur les communautés autochtones, ainsi que l’intégration des connaissances scientifiques et autochtones relatives aux tendances en matière de biodiversité dans les contextes historique et actuel sont nécessaires pour orienter plus efficacement la planification de la conservation et appuyer les communautés autochtones qui sont des utilisateurs finaux importants des données sur les répercussions sur la biodiversité.
Effets des facteurs de stress sur les services écosystémiques
Messages clés
Les fonctions essentielles que sont le stockage, la purification et l’effet tampon de l’eau, assurées par les écosystèmes aquatiques (notamment les cours d’eau, les plans d’eau et les milieux humides), soutiennent toute la vie sur Terre.
Ces services sont menacés par de nombreuses pressions d’origine humaine qui limitent ou détériorent les fonctions essentielles des écosystèmes, comme en témoigne la perte de biodiversité plus rapide dans les écosystèmes d’eau douce que dans les autres écosystèmes.
La protection des services fournis par les écosystèmes d’eau douce exigera que nous dépassions une approche centrée sur l’humain pour prendre en compte les besoins plus vastes de toute la biodiversité sur Terre, en adoptant des approches de rétablissement plus globales telles que la remise à l’état sauvage.
Résumé
Les écosystèmes d’eau douce du Canada fournissent de nombreux services écosystémiques comme de la nourriture, de l’eau filtrée et de l’air pur. Comme la population canadienne en dépend pour sa santé et son bien-être, il est essentiel de protéger ces services pour assurer la durabilité environnementale et économique. Les services écosystémiques d’eau douce du Canada sont touchés par de nombreux facteurs de changement global tels que les changements climatiques et les émissions de contaminants. Malgré leur importance, nombre de ces services restent méconnus et difficiles à mesurer et, par conséquent, il est difficile de les intégrer dans les plans de gestion. En outre, le rôle des fonctions essentielles des écosystèmes dans les services fournis à la biodiversité au sens large est peu étudié. Par conséquent, il est urgent de mener des études de cas dans le cadre de projets interministériels et interdisciplinaires portant essentiellement sur les services écosystémiques et se concentrant sur des solutions axées sur la nature pour mettre en œuvre l’approche « Une seule santé ». Il faut mettre en place des mécanismes d’élaboration conjointe pour développer la recherche sur les services écosystémiques avec les groupes autochtones et d’autres intervenants et redoubler d’efforts pour intégrer les services écosystémiques dans la réflexion stratégique. Il faut également des infrastructures et des outils de surveillance qui favorisent la protection de l’environnement. À plus long terme, il faudra mettre en œuvre une protection de l’ensemble de l’écosystème, y compris de l’eau douce, et des liens entre les mandats exigent une solution pangouvernementale. Cela permettrait de préciser les besoins en matière d’évaluation de la surveillance et les exigences de protection, de mieux déterminer et quantifier les services écosystémiques stratégiques fournis par les eaux douces du Canada, et de tirer profit de l’utilisation des données et des informations sur les services écosystémiques.
Principaux besoins et lacunes
Évaluer l’état des fonctions critiques des écosystèmes. Il est urgent de mener des recherches pour évaluer l’état des fonctions critiques des écosystèmes qui sous-tendent les services, dont beaucoup ne peuvent pas être facilement mesurés de manière utile à l’échelle, afin d’améliorer les pratiques de restauration dans les écosystèmes d’eau douce, et donc de maintenir ou d’améliorer leur résilience.
Soutenir de grandes équipes de recherche interdisciplinaires et transnationales axées sur les services écosystémiques. Il est nécessaire de mettre en place de grandes équipes de recherche diverses, interdisciplinaires et intergouvernementales, incluant des communautés autochtones et des groupes scientifiques citoyens pour évaluer correctement l’interconnexion et les interdépendances inhérentes à de nombreux processus et propriétés écosystémiques qui sous-tendent les services écosystémiques à l’échelle nationale.
Élaborer une série d’indicateurs de services écosystémiques. Des indicateurs de services écosystémiques informatifs, inclusifs et ciblés sont nécessaires pour communiquer la réussite ou l’échec des projets de gestion des écosystèmes et contribueront à réduire l’empreinte environnementale des développements futurs.
Gestion des débits environnementaux
Messages clés
Les ressources en eau douce sont de plus en plus menacées par les activités humaines et les changements climatiques, malgré la reconnaissance croissante des valeurs écologiques, sociales et culturelles des rivières et des masses d’eau liées.
Les cadres holistiques de flux environnementaux offrent une voie à suivre pour déterminer la quantité, le moment, la variabilité et la qualité des flux d’eau douce et des niveaux d’eau nécessaires aux écosystèmes aquatiques et aux populations.
Résumé
Les débits environnementaux décrivent le moment, la quantité et la qualité des débits et des niveaux d’eau douce nécessaires au maintien des écosystèmes d’eau douce et des services écologiques, des moyens de subsistance durables et du bien-être qu’ils procurent. Les débits et les niveaux d’eau douce varient naturellement en fonction de la géographie, du climat, de la période de l’année et des phénomènes extrêmes. Les activités humaines et l’augmentation de la demande en eau accentuent encore davantage le débit d’eau douce (p. ex., par la production d’hydroélectricité ou le prélèvement d’eau pour l’agriculture). Les modifications peuvent avoir une incidence sur les attributs d’une rivière nécessaires au maintien d’écosystèmes d’eau douce sains, y compris les conditions physiques (p. ex., érosion des berges, perte de plaines d’inondation) et écologiques (p. ex., modification des repères environnementaux pour les plantes et les animaux aquatiques). Ces incidences sur les débits environnementaux peuvent également être aggravées par les changements climatiques, qui entraînent des modifications du moment et de la quantité de fonte des neiges et une augmentation des précipitations extrêmes et des périodes de sécheresse. Une meilleure compréhension des changements et des schémas des régimes d’écoulement grâce à l’évaluation des débits environnementaux peut contribuer de manière significative à la gestion de l’eau et à la planification. Les experts élaborent actuellement des moyens de relier les informations entre les flux d’eau environnementaux, l’écologie, les aspects socioculturels et la gouvernance à l’échelle des bassins hydrographiques. Cette approche associe les valeurs sociétales aux besoins environnementaux. Bien que plus complexes, ces méthodes sont continuellement améliorées, notamment pour tenir compte du défi permanent que représentent les changements climatiques. Pour répondre à ces besoins de recherche et éclairer les décisions, il faut innover en matière de surveillance et de recherche, notamment en ayant recours à l’échantillonnage basé sur l’ADN pour évaluer la santé des écosystèmes aquatiques en vue d’établir des relations débit-écologie et l’application d’approches de télédétection à la quantité d’eau douce.
Principaux besoins et lacunes
Intégrer la science occidentale et autochtone. Il faut élaborer et appliquer des cadres holistiques de débits environnementaux à l’échelle des bassins hydrographiques et des régions qui associent à la fois la science occidentale et les connaissances autochtones pour guider de manière plus inclusive la gestion durable des débits.
Valider de nouvelles méthodes rapides d’évaluation hydroenvironnementale. Des outils de géographie et de cartographie améliorés, y compris la télédétection, sont nécessaires pour comprendre l’utilisation et l’allocation de l’eau à l’échelle pancanadienne afin de développer et de valider de nouvelles méthodes d’évaluation hydroenvironnementale rapide pour tester les relations débit-écologie dans le cadre des approches de débits environnementaux.
Élaborer un réseau amélioré d’évaluation des eaux douces. Un réseau amélioré d’évaluation des eaux douces, qui associe des sites de surveillance hydrométrique, biologique et de la qualité de l’eau, est nécessaire pour cibler et combler les lacunes de la recherche en matière de préservation, de protection et de gestion des écosystèmes d’eau douce.
Conclusion et prochaines étapes
Par l’aperçu et par l’atelier sur les sciences de l’eau douce, il a été largement reconnu qu’une communication, des liens et une collaboration accrus sont nécessaires pour que nous puissions relever les défis complexes des milieux d’eau douce à mesure que le climat évolue et que celui-ci a lui aussi des répercussions sur la population canadienne. Ces efforts seraient partagés entre les ministères fédéraux ayant des mandats interreliés, en plus des grands partenaires, bénéficiaires et autres intervenants des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales, des collectivités, de l’industrie et autres. La compréhension et l’application des connaissances scientifiques sur les écosystèmes aquatiques au pays sont l’assise d’une intendance de l’eau douce et d’une stratégie efficaces. Il est donc évident que des sciences de l’eau douce rigoureuses et collaboratives sont essentielles pour susciter une prise de décision fondée sur des preuves.
L’exploitation de la science de l’eau douce pour la prise de décision nécessite des mécanismes et une expertise modernes pour traduire et mobiliser efficacement ces connaissances auprès d’un public ciblé, au moment où il en a besoin et de manière à pouvoir agir. Amélioration de la communication bidirectionnelle des connaissances, des conseils et des activités scientifiques entre les détenteurs de connaissances et les utilisateurs des sciences dans les ministères et organismes fédéraux à vocation scientifique et d’autres gouvernements, en collaboration avec des experts, et de représenter avec respect les divers points de vue et systèmes de connaissances autochtones distincts. Cette capacité de communication améliorée permettrait de faire connaître et d’allier les efforts complémentaires et de tirer davantage parti des possibilités de collaboration interdisciplinaire pour relever les principaux défis du Canada en matière d’eau douce. Par conséquent, l’évaluation peut être considérée comme une occasion de faire avancer de nouvelles questions, de nouveaux défis et de nouvelles occasions d’éclairer la discussion sur la responsabilité, l’intendance, la gestion, l’intervention et les sciences intégrées de l’eau douce en collaboration avec les principaux partenaires au sein du gouvernement fédéral et en dehors de celui-ci.
Cinq éléments fondamentaux ont été soulevés à plusieurs reprises dans l’évaluation en tant que grands résultats à mettre en œuvre :
- Une coordination scientifique nationale pour orienter la collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire sur les priorités et les besoins pancanadiens.
- Des sciences de l’eau douce axées sur les utilisateurs pour appuyer les priorités locales et régionales et celles propres aux bassins versants au sein d’un cadre national.
- La mobilisation des connaissances centrée sur les utilisateurs comme mécanisme d’intégration des outils et des experts afin de mieux rapprocher, traduire et refléter les besoins des utilisateurs des sciences de l’eau douce au Canada.
- Des outils numériques, des infrastructures essentielles et novatrices et des normes pour améliorer les sciences de l’eau douce ainsi que pour opérationnaliser la connectivité et la mobilisation des connaissances sur l’eau douce.
- Raccordement, tissage et tressage du savoir autochtone, pour représenter avec respect les divers points de vue et systèmes de connaissances autochtones distincts.
Bien que l’évaluation ne soit pas destinée à constituer une collection définitive de tous les enjeux relatifs à l’eau douce auxquels notre pays doit faire face, elle constitue un point de départ qui permettra d’élaborer un programme national pour les sciences de l’eau douce.
Cette prochaine étape serait un moyen de cibler la collaboration et la coordination des sciences de l’eau douce afin d’éclairer les décisions de gestion et d’investissement. On pourrait ainsi établir l’ordre des priorités, harmoniser et améliorer la coordination des sciences de l’eau douce à l’échelle nationale, ce qui constituerait une feuille de route pour les investisseurs, les intervenants et les consommateurs des sciences de l’eau douce au pays. En fin de compte, ce programme ferait progresser la science de l’eau douce au Canada en commençant par les besoins ou les défis les plus urgents afin d’atteindre les objectifs nationaux et régionaux d’intendance durable de l’eau douce.
Détails de la page
- Date de modification :